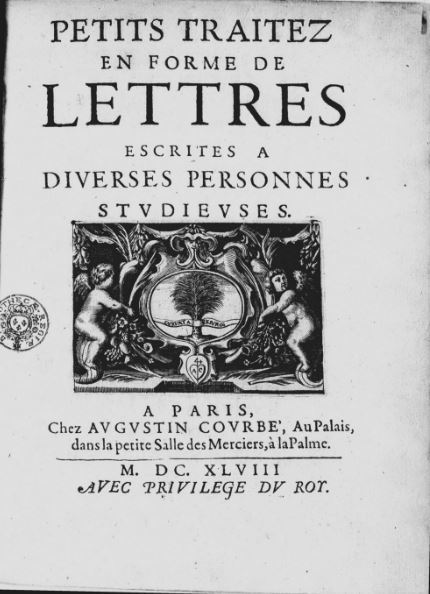LA MOTHE LE VAYER, François de, « De la peinture. Lettre IX », Petits traitez en forme de lettres escrites à diverses personnes studieuses, Paris, A. Courbé, 1648, p. 97-122.
Ses premiers textes publiés sont neuf Dialogues faits à l’imitation des Anciens d’Orasius Tubero (1630 et 1631), qu'il publie sous le nom d’emprunt d’Orasius Tubero. Remarqué par Richelieu, celui-ci lui confie, à partir de 1632, la charge de défendre ses politiques. François de La Mothe Le Vayer est élu à l’Académie française en 1639.
Sa « Lettre sur la peinture », parue pour la première fois en 1648 dans les Petits traitez en forme de lettres escrites à diverses personnes studieuses (Paris, A. Courbé), constitue sa seule intervention dans le domaine de la théorie de l’art. S'il est quelque fois cité dans le cercle des amateurs d'art, son activité de théoricien reste peu connue. Celle-ci est très liée à sa fonction de précepteur auprès du Duc d’Anjou. Faisant référence à un discours prononcé en 1640, La Mothe le Vayer consacre également quelques pages à la peinture dans son Discours de l’instruction de Monseigneur le Dauphin à Mgr l’éminentissime Cardinal Duc de Richelieu, in Œuvres de François de la Mothe le Vayer, … t. 1, partie 1, Dresde, 1756-1759, p. 219-223. Il se réfère à cet écrit au début de sa lettre sur la peinture : « J’ai fait voir ailleurs, comment elle méritait l’estime des plus Grands Princes […], & j’en ai nommé plusieurs, qui l’ont cultivée avec succès, ne croiant pas se faire tort de tenir le pinceau de la même main, dont ils manioient le Sceptre & l’Epée. »
Polygraphe, il a écrit sur tous les sujets. La publication des Petits traités en forme de lettres s’échelonne de 1649 à 1660. La Lettre sur la peinture appartient au premier ensemble. Elle sera ensuite rééditée dans les diverses éditions des œuvres complètes de la Mothe.
En s'appuyant sur de nombreux parallèles entre antique et moderne, elle évoque la dignité de la peinture, les qualités et les défauts des peintres. Les sources antiques paraissent souvent lues à la lumière de leurs interprétations modernes, mais ne sont toutefois pas mentionnées de façon explicite.
Mathilde Bert
Dedication
A Monseigneur Molé Premier Président Du Parlement
Table des matières at n.p
Épître(s) at n,p
Dédicace(s) at n.p
Privilèges at n.p
Catalogue at n.p
LA MOTHE LE VAYER, François de, « Petits traités en forme de lettres écrites à diverses personnes », Œuvres de François de la Mothe le Vayer, Paris, A. Courbé, 1654, 2 vol.
LA MOTHE LE VAYER, François de, Petits traités en forme de lettres écrites à diverses personnes [1649-1662], Lettre IX, « De la peinture », Paris, A. Courbé, 1656, 2 vol.
LA MOTHE LE VAYER, François de, « Petits traités en forme de lettres écrites à diverses personnes », Œuvres de François de la Mothe le Vayer, Paris, A. Courbé, 1662, 2 vol, p. 437-446.
LA MOTHE LE VAYER, François de, « Petits traités en forme de lettres écrites à diverses personnes », Œuvres de François de la Mothe le Vayer, Nouvelle édition, augmentée de plusieurs nouveaux traitte, Paris, L. Billaine, 1669, 15 vol.
LA MOTHE LE VAYER, François de, Œuvres : Nouvelle édition revue et augmentée, précédé de l’Abrégé de la vie de La Mothe Le Vayer, Genève, Slatkine Reprints, 1970, 2 vol., vol. II.
SCHNAPPER, Antoine, Curieux du Grand siècle. Les collections d’art en France au XVIIe siècle, Paris, Flammarion, 1994.
FILTERS
QUOTATIONS
Nonobstant que Seneque traite si mal la Peinture dans une de ses epistres ; qu’il luy refuse le rang avantageus que d’autres luy donnent entre les arts liberaus, la mettant mesme d’une severité par trop Stoique au nombre de ceux qui ne servent qu’aus voluptez : Si faut-il avouez qu’elle merite par beaucoup de considerations qu’on en fasse bien plus d’estat. Elle est tres-ancienne […]. Philostrate a raison d’escrire que si elle n’est de l’invention des Dieux & de la Nature, pour le moins ne sçauroit-on nier qu’elle ne soit de tems immemorial, & tresamie de cette mesme nature […]. J’ay fait voir ailleurs comme elle meritoit l’estime des plus grands Princes […], & j’en ai nommé plusieurs qui l’ont cultivée avec succez, ne croyant pas se faire tort de tenir le pinceau de la mesme main dont ils manioient le sceptre & l’espée. {Instr. de M. le Dauphin p. 209.}
Il est certain que Socrate apprit de son pere l’art de tailler des Statuës, qui fait partie de celuy dont nous parlons [ndr : la peinture], selon que les Grecs ont consideré la Plastique, & la Zographie, dependantes d’un mesme dessein.
Et nous lisons dans ce beau rapport que fait Quintilien des Peintres excellens aus plus parfait Orateurs, qu’Euphranor avoit conjoint toutes les autres sciences à celle de la Peinture, ce qui oblige Quintilien â luy comparer son grand Maistre Ciceron. Sans mentir l’ouvrage du pinceau depend bien plus de la teste que de la main ; & si l’historien de la Nature à peu dire que les Lamproyes avoient l’ame au bout de la queüe, rien ne doit nous empescher de prononcer que l’esprit des Peintres de reputation semble estre tout entier au bout de leurs doigts {Pline l. 32. c. 2}.
Ils [ndr : les peintres] font des figures qui parlent, & le Jupiter de Phidias inspiroit plus de devotion au dire d’un Payen, que la Religion n’en prescrivoit […]. La doctrine paroist mieus dans un tableau que dans un livre, parce que le premier nous instruit tout d’un coup de ce que l’autre ne nous fait connoistre qu’à divers tems & à la longue. Aussi est-il certain qu’il y a des Nations, comme celle de Mexique dans le nouveau monde, à qui la peinture tenoit lieu de lettres.
PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)
Le terme apparaît ici dans un éloge de la peinture.
Conceptual field(s)
Et nous lisons dans ce beau rapport que fait Quintilien des Peintres excellens aus plus parfait Orateurs, qu’Euphranor avoit conjoint toutes les autres sciences à celle de la Peinture, ce qui oblige Quintilien â luy comparer son grand Maistre Ciceron. Sans mentir l’ouvrage du pinceau depend bien plus de la teste que de la main ; & si l’historien de la Nature à peu dire que les Lamproyes avoient l’ame au bout de la queüe, rien ne doit nous empescher de prononcer que l’esprit des Peintres de reputation semble estre tout entier au bout de leurs doigts
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Ils [ndr : les peintres] font des figures qui parlent, & le Jupiter de Phidias inspiroit plus de devotion au dire d’un Payen, que la Religion n’en prescrivoit […]. La doctrine paroist mieus dans un tableau que dans un livre, parce que le premier nous instruit tout d’un coup de ce que l’autre ne nous fait connoistre qu’à divers tems & à la longue. Aussi est-il certain qu’il y a des Nations, comme celle de Mexique dans le nouveau monde, à qui la peinture tenoit lieu de lettres.
PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)
Conceptual field(s)
Et pour preuve de ce qu’elle [ndr : la peinture] peut estre mise au rang des disciplines serieuses & honorables tout ensemble, il ne faut que considerer comme ce Qu. Pedius muet naturel, que Jule Cesar avoit laissé son heritier conjointement avec Auguste, fut appliqué à l’estude de cét art par l’avis, qu’Auguste trouva fort bon, de l’Orateur Messalla son parent maternel. Pline. l. 35. c. 4.
Selon Pline (Histoire naturelle, livre XXXV, 21-22), la dignité de la peinture s’accrut à Rome quand Messala, approuvé par Auguste, fit apprendre la peinture à Q. Pedius, muet de naissance. Il s’agit de l’argument souvent rebattu selon lequel la peinture s’ennoblit dès lors qu’elle est enseignée à des enfants nobles.
Conceptual field(s)
[…] la mesme science [ndr : la peinture] qui nous apprent ce que c’est que la Verité, nous fait de plus des leçons du mensonge : Outre que la peinture nous porte à bien juger de la perfection de tout ce qu’elle represente, son art nous fournit des maximes pour en discerner les vices, & pour en censurer ce qu’y rencontre de defectueus. Ainsi l’on trouva mesme à redire au Jupiter de Phidias […].
PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)
Conceptual field(s)
PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)
Conceptual field(s)
PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)
Conceptual field(s)
PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)
Conceptual field(s)
Quoy qu’il en soit, cela vous peut faire souvenir du reproche qu’on fit à un ancien Orateur, d’avoir tres-improprement parlé d’un Promethée peint au Temple de Minerve par Parrhasius dans Athenes. Car luy estant venu dans l’esprit ce qu’on avoit escrit des raisins representez par Zeuxis, que de petits moineaux venoient bequeter ; il creut qu’il ne pouvoit mieus louër ce Promethée, que de dire qu’il estoit tel qu’on voyoit souvent les Vaultours se jetter dessus pour luy perçer le costé, & se repaistre de son foye. Cependant c’estoit tres-mal rencontré à luy, d’autant qu’il n’est pas imaginable que des Vaultours entrent dans un Temple frequenté comme celuy de Minerve Athenienne, encore que des moineaux se puissent hazarder d’aller donner du bec contre un tableau exposé au jour, selon que les Peintres ont accoustumé d’y mettre leurs ouvrages.
L’on ne sçauroit donc nier que la peinture ne soit fort spirituelle, & tres propre à exercer le jugement en beaucoup de façons.
PARRHASIOS, Prométhée
ZEUXIS, Raisins
Conceptual field(s)
PARRHASIOS, Prométhée
ZEUXIS, Raisins
Conceptual field(s)
Mais son principal usage [ndr : la peinture] n’est pas seulement en de semblables observations, ny, comme dit Aristote {L. 8. Polit. c. 3.}, à donner une si parfaite connoissance des tableaus qu’on n’y puisse jamais estre trompé, soit pour la main ou la maniere des grands maistres, soit pour le fin discernement des copies d’avec les originaux, soit pour le prix qui depend presque tousjours de la fantaisie. Le plus grand avantage qu’on en tire vient de ce qu’elle nous apprend en quoy consiste la derniere beauté de tout ce qu’elle represente, & sur tout celle du corps humain.
Car il ne faut point douter que les Peintres ne jugent ordinairement mieux que le reste des hommes de la beauté humaine, tant à cause des regles qu’ils ont à l’esgard de la proportion des membres & des couleurs qui leur conviennent, que pource qu’ils exerçent incessamment leur imagination à former des Idées les plus accomplies qui se puissent concevoir.
Conceptual field(s)
Le plus grand avantage qu’on en tire vient de ce qu’elle nous apprend en quoy consiste la derniere beauté de tout ce qu’elle represente, & sur tout celle du corps humain.
Car il ne faut point douter que les Peintres ne jugent ordinairement mieux que le reste des hommes de la beauté humaine, tant à cause des regles qu’ils ont à l’esgard de la proportion des membres & des couleurs qui leur conviennent, que pource qu’ils exerçent incessamment leur imagination à former des Idées les plus accomplies qui se puissent concevoir.
Mais son principal usage [ndr : la peinture] n’est pas seulement en de semblables observations, ny, comme dit Aristote {L. 8. Polit. c. 3.}, à donner une si parfaite connoissance des tableaus qu’on n’y puisse jamais estre trompé, soit pour la main ou la maniere des grands maistres, soit pour le fin discernement des copies d’avec les originaux, soit pour le prix qui depend presque tousjours de la fantaisie.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Car il ne faut point douter que les Peintres ne jugent ordinairement mieux que le reste des hommes de la beauté humaine, tant à cause des regles qu’ils ont à l’esgard de la proportion des membres & des couleurs qui leur conviennent, que pource qu’ils exerçent incessamment leur imagination à former des Idées les plus accomplies qui se puissent concevoir.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Or dautant que les graces ont esté partagées de tems immemorial entre ceus de cette profession, comme elles le sont par tout ailleurs, & qu’encore aujourd’huy les Peintres qui excellent en quelque chose, sont surmontez par d’autres qui ont de l’avantage à leur tour, n’arrivant que rarement qu’un seul possede la perfection de son art avec tant d’eminence, qu’il n’y soit devancé par personne de quelque costé qu’on le puisse prendre. […]
« Charité » est un néologisme issu du latin « charitas », provenant lui-même du grec « kháris », qui signifie « grâce ». Depuis Pline (Histoire naturelle, Livre XXXV, 79-80, 85), la théorie de l’art associe fréquemment la grâce des manières de l’artiste à celle de son art, considérant l’union de ces deux « grâces », chez des artistes comme Apelle et Raphaël, comme un « don des Grâces ». La Mothe joue ici sur cette triple application du mot « grâce » : déesse antique, agrément de l’art et affabilité des manières. Reprenant la définition issue de la critique d’Apelle par Protogène (XXXV, 79-80), il conçoit la grâce de l’art comme opposée à l’excès d’exactitude.
Conceptual field(s)
Le peintre Aristide est le premier de tous qui se servit de la Morale dans sa profession, & qui sçeut pendre l’Ame avecque ses pensées aussi bien que le corps, par l’expression visible de tous les mouvemens interieurs ; les couleurs dont il [ndr : Aristide] se servoit estoient neantmois trouvées un peu rudes de son tems.
Aristote {L. de Poet. c. 6} le [ndr : Zeuxis] reprent aussi de n’avoir pas exprimé comme Polygnotus les mœurs, ny fait comprendre les passions, quoy que Pline {L. 35. c. 9. & 10.} dise qu’elles étoient visibles dans sa Penelope qui fit un de ses chefs-d’œuvres […]. Le peintre Aristide est le premier de tous qui se servit de la Morale dans sa profession, & qui sçeut pendre l’Ame avecque ses pensées aussi bien que le corps, par l’expression visible de tous les mouvemens interieurs ; les couleurs dont il [ndr : Aristide] se servoit estoient neantmois trouvées un peu rudes de son tems.
Timanthe est prisé d’avoir tousjours donné davantage à comprendre dans ses ouvrages, que son pinceau ne representoit, et fait en sorte que son esprit y paroissoit plus grand que l’industrie de sa main, bien qu’il l’eust tres-exquise. Ainsi pour faire concevoir la grandeur de son Cyclope dormant, & fait en petit volume, il mit des Satyres auprés de luy qui mesuroient son poulce avec une perche. Certes nous luy pouvons comparer pour ce regard le sçavant Rubens que nous venons de perdre, qui a tousjours joint l’invention à l’excellence de son art, & ce qu’il tenoit d’une profonde lecture à la beauté de son colorit.
TIMANTHE, le grand cyclope
La citation latine reprend des propos, cités plus haut, de l’éloge de Pline sur Timanthe (Histoire naturelle, Livre XXXV, 74), que La Mothe attribue ici aux œuvres de Rubens « où on comprend plus que ce qui est effectivement peint, et bien que l’art soit extrême, l’ingenium va cependant au-delà ». La Mothe choisit donc de traduire « ingenium » par « esprit », qu’il oppose à « l’industrie de la main », comme « l’invention » à l’ « art ».
Conceptual field(s)
Timanthe est prisé d’avoir tousjours donné davantage à comprendre dans ses ouvrages, que son pinceau ne representoit, et fait en sorte que son esprit y paroissoit plus grand que l’industrie de sa main, bien qu’il l’eust tres-exquise. Ainsi pour faire concevoir la grandeur de son Cyclope dormant, & fait en petit volume, il mit des Satyres auprés de luy qui mesuroient son poulce avec une perche. Certes nous luy pouvons comparer pour ce regard le sçavant Rubens que nous venons de perdre, qui a tousjours joint l’invention à l’excellence de son art, & ce qu’il tenoit d’une profonde lecture à la beauté de son colorit. Les Galeries du Palais d’Orleans le tesmoigneront autant qu’elles dureront, avec le reste de ses pieces, ubi intelligitur plus semper quam pingitur ; et cum ars summa sit, ingenium tament ultra artem est Plin. ib.
RUBENS, Peter Paul, Cycle de Marie de Medicis , 1622 - 1625, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre, INV. 1769.
TIMANTHE, le grand cyclope
Conceptual field(s)
RUBENS, Peter Paul, Cycle de Marie de Medicis , 1622 - 1625, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre, INV. 1769.
TIMANTHE, le grand cyclope
La citation latine reprend des propos, cités plus haut, de l’éloge de Pline sur Timanthe (Histoire naturelle, Livre XXXV, 74), que La Mothe attribue ici aux œuvres de Rubens « où on comprend plus que ce qui est effectivement peint, et bien que l’art soit extrême, l’ingenium va cependant au-delà ». La Mothe choisit donc de traduire « ingenium » par « esprit », qu’il oppose à « l’industrie de la main », comme « l’invention » à l’ « art ».
Conceptual field(s)
RUBENS, Peter Paul, Cycle de Marie de Medicis , 1622 - 1625, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre, INV. 1769.
TIMANTHE, le grand cyclope
La citation latine reprend des propos, cités plus haut, de l’éloge de Pline sur Timanthe (Histoire naturelle, Livre XXXV, 74), que La Mothe attribue ici aux œuvres de Rubens « où on comprend plus que ce qui est effectivement peint, et bien que l’art soit extrême, l’ingenium va cependant au-delà ». La Mothe choisit donc de traduire « ingenium » par « esprit », qu’il oppose à « l’industrie de la main », comme « l’invention » à l’ « art ».
Conceptual field(s)
RUBENS, Peter Paul, Cycle de Marie de Medicis , 1622 - 1625, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre, INV. 1769.
TIMANTHE, le grand cyclope
La citation latine reprend des propos, cités plus haut, de l’éloge de Pline sur Timanthe (Histoire naturelle, Livre XXXV, 74), que La Mothe attribue ici aux œuvres de Rubens « où on comprend plus que ce qui est effectivement peint, et bien que l’art soit extrême, l’ingenium va cependant au-delà ». La Mothe choisit donc de traduire « ingenium » par « esprit », qu’il oppose à « l’industrie de la main », comme « l’invention » à l’ « art ».
Conceptual field(s)
RUBENS, Peter Paul, Cycle de Marie de Medicis , 1622 - 1625, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre, INV. 1769.
TIMANTHE, le grand cyclope
La citation latine reprend des propos, cités plus haut, de l’éloge de Pline sur Timanthe (Histoire naturelle, Livre XXXV, 74), que La Mothe attribue ici aux œuvres de Rubens « où on comprend plus que ce qui est effectivement peint, et bien que l’art soit extrême, l’ingenium va cependant au-delà ». La Mothe choisit donc de traduire « ingenium » par « esprit », qu’il oppose à « l’industrie de la main », comme « l’invention » à l’ « art ».
Conceptual field(s)
Le merite du Caravaggio à faire apres le naturel, ny son artifice dans l’obscur et le lumineux, ny les graces qu’il mettoit aux derniers traits de sa besongne, ne m’obligent pas tant à tirer quelque parallele entre luy & Parrhasius, que cette humeur fiere qui le dominoit, & qui luy faisoit mespriser avec ceux de son temps tous les anciens.
Mais un autre eloge que Pline donne à Parrhasius, d’avoir le premier enrichy la peinture de la Symmetrie, ou de cette proportion que doivent avoir les parties entr’elles, & eu esgard à leur tout ; me donne un nouveau sujet de dire qu’il n’a point eu de semblables dans le dernier siecle, si nous n’attribuons cét honneur à Albert Durer, & à Michel-Ange Buonarotte. [...] Et qui ne sçait comme tout le monde à reconnu Michel-Ange pour incomparable dans toutes les trois parties, d’Architecture, Sculpture & Peinture ? Et comme personne n’a jamais mieux enseigné que luy à reconnoistre par l’ongle la grandeur du Lion ? Ex ungue Leonem. Il est vray que luy-mesme vouloit ceder la palme à Albert Durer, comme à celuy qui luy avoit tracé le chemin, dans lequel son seul avantage venoit des statuës Grecques & des antiques de Rome, dont il transportoit les ornemens & les artifices sur ses ouvrages, ce que la demeure de l’autre en Allemagne ne luy permettoit pas de faire. Ils ont pourtant esté repris tous deux du mesme deffaut qu’on reprochoit à Demetrius, d’avoir negligé par trop de rendre leurs ouvrages agreables, pourveu qu’ils fussent fort semblables, ne se souciant que d’aller apres le naturel ; nam Demetrius tanquam nimius in eo reprehenditur, & fuit similitudinis quam pulchritudinis amantior.
DÉMÉTRIOS
DÜRER, Albrecht
MICHELANGELO (Michelangelo Buonarroti)
PARRHASIUS (Parrhasios)
PLINIUS, L'Ancien
QUINTILIANUS
Conceptual field(s)
DÉMÉTRIOS
DÜRER, Albrecht
MICHELANGELO (Michelangelo Buonarroti)
PARRHASIUS (Parrhasios)
PLINIUS, L'Ancien
QUINTILIANUS
Conceptual field(s)
Mais un autre eloge que Pline donne à Parrhasius, d’avoir le premier enrichy la peinture de la Symmetrie, ou de cette proportion que doivent avoir les parties entr’elles, & eu esgard à leur tout ; me donne un nouveau sujet de dire qu’il n’a point eu de semblables dans le dernier siecle, si nous n’attribuons cét honneur à Albert Durer, & à Michel-Ange Buonarotte. En effet, Quintilien adjouste que Parrhasius sceut si bien donner les regles de cette symmetrie, & prescrire ce qu’il falloit observer pour cela, qu’on le nommoit ordinairement le Legislateur, tous ceux son mestier tenant alors pour constant que la figure des Dieux & des Heros ne pouvoit estre bien representée que sur le modele qu’il en avoit laissé. Et qui ne sçait comme tout le monde à reconnu Michel-Ange pour incomparable dans toutes les trois parties, d’Architecture, Sculpture & Peinture ? Et comme personne n’a jamais mieux enseigné que luy à reconnoistre par l’ongle la grandeur du Lion ? Ex ungue Leonem. Il est vray que luy-mesme vouloit ceder la palme à Albert Durer, comme à celuy qui luy avoit tracé le chemin, dans lequel son seul avantage venoit des statuës Grecques & des antiques de Rome, dont il transportoit les ornemens & les artifices sur ses ouvrages, ce que la demeure de l’autre en Allemagne ne luy permettoit pas de faire. Ils ont pourtant esté repris tous deux du mesme deffaut qu’on reprochoit à Demetrius, d’avoir negligé par trop de rendre leurs ouvrages agreables, pourveu qu’ils fussent fort semblables, ne se souciant que d’aller apres le naturel ; nam Demetrius tanquam nimius in eo reprehenditur, & fuit similitudinis quam pulchritudinis amantior.
DÉMÉTRIOS
DÜRER, Albrecht
MICHELANGELO (Michelangelo Buonarroti)
PARRHASIUS (Parrhasios)
PLINIUS, L'Ancien
QUINTILIANUS
Conceptual field(s)
Et qui ne sçait comme tout le monde à reconnu Michel-Ange pour incomparable dans toutes les trois parties, d’Architecture, Sculpture & Peinture ? Et comme personne n’a jamais mieux enseigné que luy à reconnoistre par l’ongle la grandeur du Lion ? Ex ungue Leonem. Il est vray que luy-mesme vouloit ceder la palme à Albert Durer, comme à celuy qui luy avoit tracé le chemin, dans lequel son seul avantage venoit des statuës Grecques & des antiques de Rome, dont il transportoit les ornemens & les artifices sur ses ouvrages, ce que la demeure de l’autre en Allemagne ne luy permettoit pas de faire. Ils ont pourtant esté repris tous deux du mesme deffaut qu’on reprochoit à Demetrius, d’avoir negligé par trop de rendre leurs ouvrages agreables, pourveu qu’ils fussent fort semblables, ne se souciant que d’aller apres le naturel ; nam Demetrius tanquam nimius in eo reprehenditur, & fuit similitudinis quam pulchritudinis amantior.
DÉMÉTRIOS
DÜRER, Albrecht
MICHELANGELO (Michelangelo Buonarroti)
PARRHASIUS (Parrhasios)
PLINIUS, L'Ancien
QUINTILIANUS
Conceptual field(s)
DÉMÉTRIOS
DÜRER, Albrecht
MICHELANGELO (Michelangelo Buonarroti)
PARRHASIUS (Parrhasios)
PLINIUS, L'Ancien
QUINTILIANUS
Conceptual field(s)
Raphaël d’Urbin est celuy qui a pû de mesme reprendre le soin extréme de ces grands hommes dont nous venons de parler, qui ne sacrifioient pas aux Graces comme luy. Il fut excellent en tout, quoy qu’il changeast par fois de maniere : Il donna l’agrement avec la naturel à la Peinture, proprement prise pour celle qui employe les couleurs […].
Comme Appelle accusa de fort bonne grace tous ceux de son art de cette trop grande exactitude, & de n’avoir pas assez fait estat dans leurs travaux de la Charité des Grecs, se moquant de Ptotogène [sic] qui ne pouvoit oster sa main de dessus un tableau, memorabili praecepto, nocere saepe nimiam diligentiam : Raphaël d’Urbin est celuy qui a pû de mesme reprendre le soin extréme de ces grands hommes dont nous venons de parler, qui ne sacrifioient pas aux Graces comme luy. Il fut excellent en tout, quoy qu’il changeast par fois de maniere : Il donna l’agrement avec la naturel à la Peinture, proprement prise pour celle qui employe les couleurs […].
« Charité » est un néologisme issu du latin « charitas », provenant lui-même du grec « kháris », qui signifie « grâce ». Depuis Pline (Histoire naturelle, Livre XXXV, 79-80, 85), la théorie de l’art associe fréquemment la grâce des manières de l’artiste à celle de son art, considérant l’union de ces deux « grâces », chez des artistes comme Apelle et Raphaël, comme un « don des Grâces ». La Mothe joue ici sur cette triple application du mot « grâce » : déesse antique, agrément de l’art et affabilité des manières. Reprenant la définition issue de la critique d’Apelle par Protogène (XXXV, 79-80), il conçoit la grâce de l’art comme opposée à l’excès d’exactitude.
Conceptual field(s)
Ce que Raphaël a eu de plus commun avec Appelle, c’est que la beauté de ses pieces n’ostoit rien à la ressemblance ; de sorte qu’un Physionome pouvoit faire dessus ses conjectures, comme Apion disoit d’un Metoposcope qu’il dressoit ses jugemens certains sur le front d’une teste tirée de la main d’Appelle.
Conceptual field(s)
Ce que Raphaël a eu de plus commun avec Appelle, c’est que la beauté de ses pieces n’ostoit rien à la ressemblance ; de sorte qu’un Physionome pouvoit faire dessus ses conjectures, comme Apion disoit d’un Metoposcope qu’il dressoit ses jugemens certains sur le front d’une teste tirée de la main d’Appelle.
Le notable precepte qu’il [ndr : Appelle] donna de fuïr comme un crime ce soin scrupuleux & superflu, qui fait dire par fois que des ouvrages sont trop achevez, est cause que plusieurs chercherent leur gloire dans la promptitude, & qu’en effet ils furent loüez d’une diligence extraordinaire. Pline en nomme quelques-uns comme Philoxene, Nicophane, & leur precepteur Nicomaque les plus expeditif de tous, & qui n’a point eu son pareil en impetuosité d’esprit, pour user de ses termes. Lala, qui peignoit dans Rome du siecle de Varron avec une si grande legereté de main, que personne jamais ne l’a passée en cela.
Le notable precepte qu’il [ndr : Appelle] donna de fuïr comme un crime ce soin scrupuleux & superflu, qui fait dire par fois que des ouvrages sont trop achevez, est cause que plusieurs chercherent leur gloire dans la promptitude, & qu’en effet ils furent loüez d’une diligence extraordinaire. Pline en nomme quelques-uns comme Philoxene, Nicophane, & leur precepteur Nicomaque les plus expeditif de tous, & qui n’a point eu son pareil en impetuosité d’esprit, pour user de ses termes. Lala, qui peignoit dans Rome du siecle de Varron avec une si grande legereté de main, que personne jamais ne l’a passée en cela.
Et je croy que pour coucher encore icy ce rapport de l’ancienne peinture à la moderne, l’artifice & la promptitude de Romanelli peuvent étre jointes aux precedentes, ayant commencé & finy en neuf mois au Palais de M. le Cardinal Mazarin, le travail de cette grande galerie, que ceux qui s’y connoissent ne peuvent contempler sans estonnement.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Les nuditez à la Grecque sont plus considerables dans la peinture, que les drapperies, les armes, ny les habits soit des Romains, soit de nous, parce qu’il n’y a rien de si beau à imiter que la Nature. Il ne faut pas pourtant que ces nuditez puissent faire rougir ceux qui les regardent.
Conceptual field(s)
Celuy [ndr : le tableau] de Clesides, qui plein d’animosité contre la Reine Stratonice la representa aus prises avec un certain pescheur soupçonné d’estre en ses bonnes graces, estoit infame & satyrique tout ensemble. Car il y a des personnes, qui n’exercent pas moins la medisance avec le pinceau, qu’avec la langue ou la plume. Il s’en trouve qui passent mesme jusques à la profanation des choses du Ciel, comme quand Ctesilochus peignit Jupiter coëffé en matrone, & se pleignant au milieu des Sages-Femmes, tout prest d’accoucher de Bacchus. J’ayme mieux que le Paganisme nous fournisse des exemples de cette nature, que la vraye Religion, où il ne se trouve que trop de telles impietez. En combien d’Eglises voyons-nous l’effronterie de Praxitele, qui donnoit à Venus le visage d’une Cratine qu’il aymoit […]
La Peinture a d’autres gayetez permises, & des divertissemens innocens. Il ne peut rien tomber de si bigearre, ny de si ridicule dans l’imagination, que ses grotesques ne representent, & cette sorte de figures qui furent nommez Grylles, depuis qu’Antiphile eut habillé dans un tableau le fils de Xenophon, ou quelqu’autre qui portoit comme luy le nom de Grylle, avec des accoustremens qui faisoient rire de leur extravagance.
D’autres se sont pleus, & s’amusent encore tous les jours à charger leur toile de cuisines, remplies, outre la batterie, de toute sorte de viandes. L’on y void des Asnes chargez d’herbages, & mille autres galanteries de basse estoffe, qui acquirent le surnom de Rhyparographe à un ancien du tout addonné à cela.
C’est ainsi que les Muses sont icy differentes comme par tout ailleurs, je veux dire les inclinations, qui font que les uns réüscissent à une chose, & les autres à une autre. Le grand talent du Bassan estoit dans la representation naïve des animaux. Le genie d’Antoine Tempesta le portoit à d’escrire parfaictement du pinceau des combats sanglans, & des batailles rangées. Ceux des pays bas, qui contestent avec les Lombards de la beauté du colorit, ne peignent rien si volontiers que des mers couroucées, & des vaisseaux menacez du nauffrage.
Ceux des pays bas, qui contestent avec les Lombards de la beauté du colorit, ne peignent rien si volontiers que des mers couroucées, & des vaisseaux menacez du nauffrage.
La Peinture a d’autres gayetez permises, & des divertissemens innocens. Il ne peut rien tomber de si bigearre, ny de si ridicule dans l’imagination, que ses grotesques ne representent, & cette sorte de figures qui furent nommez Grylles, depuis qu’Antiphile eut habillé dans un tableau le fils de Xenophon, ou quelqu’autre qui portoit comme luy le nom de Grylle, avec des accoustremens qui faisoient rire de leur extravagance. D’autres se sont pleus, & s’amusent encore tous les jours à charger leur toile de cuisines, remplies, outre la batterie, de toute sorte de viandes. L’on y void des Asnes chargez d’herbages, & mille autres galanteries de basse estoffe, qui acquirent le surnom de Rhyparographe à un ancien du tout addonné à cela. C’est ainsi que les Muses sont icy differentes comme par tout ailleurs, je veux dire les inclinations, qui font que les uns réüscissent à une chose, & les autres à une autre. Le grand talent du Bassan estoit dans la representation naïve des animaux. Le genie d’Antoine Tempesta le portoit à d’escrire parfaictement du pinceau des combats sanglans, & des batailles rangées. Ceux des pays bas, qui contestent avec les Lombards de la beauté du colorit, ne peignent rien si volontiers que des mers couroucées, & des vaisseaux menacez du nauffrage. Bref le naturel est si puissant, que je lisois il n’y a gueres dans une relation des Hurons Sagard. c. 7., qu’encore qu’ils n’ayent ny l’art de la peinture, ny les instrumens propres à l’exercer tels que nous les avons, ils ne laissent pas de rencontrer admirablement en des figures qu’ils font à leur mode, en se laissant aller à la force de leur imagination.
De mesme que je vous ay nommé des Peintres de ce temps, qui semblent aller du pair avec les meilleurs des anciens […] : Aussi en avons nous d’autres, comme il y en a eu de toute antiquité, qui ne sont bons qu’à barboüiller, & qui blanchissant une muraille devant que de la peindre, feroient mieux de la peindre premierement, & puis de la blanchir. Aristote {L. 9. met. c. 8. l. 8 polit. c. 5. & l. de poe. c. 2.} met au rang de ces derniers un Pauson, dont il deffend à la jeunesse de regarder les ouvrages dépourveus de toute Morale, & qui eut neantmoins l’addresse de mettre le premier du verre au devant d’un portrait pour l’adoucir & le rendre plus agreable.
Aristote {L. 9. met. c. 8. l. 8 polit. c. 5. & l. de poe. c. 2.} met au rang de ces derniers un Pauson, dont il deffend à la jeunesse de regarder les ouvrages dépourveus de toute Morale, & qui eut neantmoins l’addresse de mettre le premier du verre au devant d’un portrait pour l’adoucir & le rendre plus agreable.