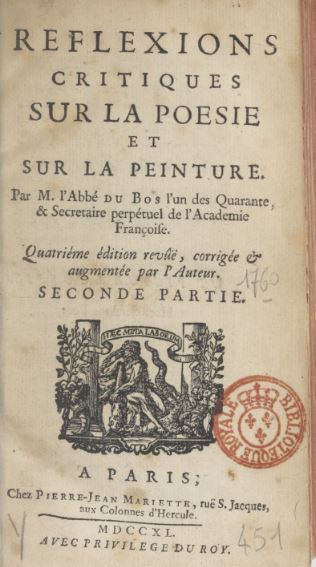DU BOS, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Seconde partie, Quatrième édition revue, corrigée et augmentée par l’Auteur, Paris, Pierre-Jean Mariette, 1740, 3 vol., vol. II.
Du Bos était un érudit, amateur d’opéra, de musique, de théâtre et de peinture, qui a fréquenté les salons et voyagé en Hollande et en Angleterre. Il n’était pas praticien et à ce titre il justifie son propos de chercher à comprendre « l’origine du plaisir que nous font les vers et les tableaux » (Livre I, Introduction), légitimant de fait le droit de parler de peinture en se fiant uniquement à son expérience de spectateur. Cette approche fait ainsi du public un acteur essentiel de la critique et de la réception des œuvres. Du Bos oppose le point de vue du spectateur à celui des artistes qui ne s’attachent pas aux effets produits par l’œuvre, mais davantage aux contraintes posées par sa fabrication. Selon lui, ces effets doivent être dramatiques, identiques à ceux que procure une représentation théâtrale. Seule la peinture d’histoire, dont la vocation est de représenter les actions humaines et l’expression des passions, fait du peintre l’égal du poète ; ces deux derniers étant sans cesse mis en parallèle dans l’ouvrage. La valeur d’une œuvre dépend donc de son pouvoir émotionnel sur le spectateur, qui est essentiellement touché par la vraisemblance, et repose sur le plaisir qu’elle procure. Mais comment expliquer l’origine de ce plaisir ? Suffit-il qu’un tableau plaise pour qu’il soit bon ? Et que faire des peintures aux sujets jugés moins nobles ? Ce questionnement touche à la fois le degré de connaissance du public et les qualités de l’artiste. C’est la capacité du peintre à traiter un sujet de manière à la fois vraisemblable et inventive qui fait la force d’une œuvre. Dans la deuxième partie de ses Réflexions, Du Bos se penche sur le peintre et la question du génie. En faisant référence à Quintilien, il définit cette dernière notion comme une qualité innée et un talent reçu de la nature. À ces deux caractéristiques s’ajoutent les conditions particulières propres au climat et au régime politique qui ont un impact sur l’expression du génie. Du Bos introduit ainsi la théorie des climats pour définir le caractère de chaque individu, de chaque peuple : « c’est de tout temps qu’on a remarqué que le climat était plus puissant que le sang et l’origine » (Livre II, section 15).
L’ouvrage de Du Bos qui, selon Voltaire, était « le livre le plus utile qu’on ait jamais écrit sur ces matières » a eu un immense succès tout au long du XVIIIe siècle en raison notamment du développement des expositions, et a été édité à dix-sept reprises en France et à l’étranger.
Stéphanie Trouvé
DU BOS, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris, J. Mariette, 1719, 2 vol.
DU BOS, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Nouvelle édition, revuë et corrigée, Utrecht, E. Néaulme, 1732, 2 vol.
DU BOS, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Paris, Pierre-Jean Mariette, 1733, 3 vol.
DU BOS, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Cinquième édition, Paris, Pierre-Jean Mariette, 1746, 3 vol.
DU BOS, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Sixième édition, Paris, Pissot, 1755, 3 vol.
DU BOS, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Septième édition, Paris, Pissot, 1770, 3 vol.
DU BOS, Jean-Baptiste, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, DÉSIRAT, Dominique (éd.), Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1993.
LOMBARD, Alfred, L'abbé Du Bos: Un Initiateur De La Pensée Moderne (1670-1742), Genève, Slatkine Reprints, 1969.
TAVERNIER, Ludwig, « " A propos d'Illusion : Jean-Baptiste Dubos'Einführung eines Begriffs in die französische Kunstkritik des 18. Jahrhunderts " », Bruckmanns Pantheon, 1984, p. 158-160.
DÉSIRAT, Dominique, « Le sixième sens de l’Abbé Dubos », Revue La Licorne, 23, 1992 [En ligne : http://licorne.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=280 consulté le 10/10/2016].
DÉMORIS, René, « Peinture, sens et violence au Siècle des Lumières : Fénelon, du Bos, Rousseau », dans MATHIEU-CASTELLANI, Gisèle (éd.), La pensée de l'image : signification et figuration dans le texte et la peinture, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1994 [En ligne : http://www.fabula.org/colloques/document630.php consulté le 12/10/2015].
LICHTENSTEIN, Jacqueline (éd.), La Peinture, Paris, Larousse, 1997.
RUSSO, Luigi (éd.), Jean-Baptiste Du Bos e l'estetica dello spettatore, Actes de colloque, Palermo (Aethetica preprint : Supplementa), Palermo, 2005, 15.
LICHTENSTEIN, Jacqueline, « L’argument de l’ignorant : de la théorie de l’art à l’esthétique », dans MICHEL, Christian et MAGNUSSON, Carl (éd.), Penser l’art dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : théorie, critique, philosophie, histoire, Actes du colloque de Lausanne, Paris, Somogy, 2013, p. 81-90.
LICHTENSTEIN, Jacqueline, Les raisons de l’art. Essai sur les théories de la peinture, Paris, Gallimard, 2014.
DAUVOIS, Daniel et DUMOUCHEL, Daniel (éd.), Vers l'esthétique : penser avec les "Réflexions critiques sur la poésie et la peinture" (1719) de Jean-Baptiste Du Bos,, Actes de colloque, Paris, , Paris, Hermann, 2015, 1.
FILTERS
QUOTATIONS
ANONYME, Apollon du Belvédère, v. 130 - v. 140, marbre, h. 224, Vatican, Vatican, Museo Pio-Clementino, inv. 1015.
POUSSIN, Le Sacrifice d'Iphigénie
POUSSIN, Nicolas, La Mort de Germanicus, 1627, huile sur toile, 148 x 198, Etats-Unis, The William Hood Dunwoody Fund 58.28.
Conceptual field(s)
ANONYME, Apollon du Belvédère, v. 130 - v. 140, marbre, h. 224, Vatican, Vatican, Museo Pio-Clementino, inv. 1015.
POUSSIN, Le Sacrifice d'Iphigénie
POUSSIN, Nicolas, La Mort de Germanicus, 1627, huile sur toile, 148 x 198, Etats-Unis, The William Hood Dunwoody Fund 58.28.
Conceptual field(s)
Le sublime de la Poësie & de la Peinture est de toucher & de plaire, comme celui de l'Eloquence est de persuader. […] Un poème ainsi qu'un tableau, ne sçaurait produire cet effet, s'il n'a pas d'autre mérite que la régularité & l'élégance de l'exécution. Le tableau le mieux peint, comme le poëme le mieux distribué & le plus exactement écrit, peuvent être des ouvrages froids & ennuïeux. Afin qu'un ouvrage nous touche, il faut que l'élégance du dessein & la verité du coloris, si c'est un tableau […] y servent à donner l'être à des objets capables par eux-mêmes de nous émouvoir & de nous plaire.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
C'est à l'invention du Peintre ou du Poëte : c'est à l'invention des idées & des images propres à nous émouvoir, & qu'il met en œuvre pour exécuter son intention qu'on distingue le grand Artisan du simple manœuvre, qui souvent est plus habile ouvrier que lui dans l'exécution.
On n'examine pas long-temps les ouvrages des grands Maîtres, sans s'appercevoir qu'ils n'ont pas regardé la régularité & les beautez de l'execution comme le dernier but de leur art, mais bien comme les moïens de mettre en œuvre des beautez d'un ordre superieur.
Ils ont observé les regles, afin de gagner notre esprit par une vrai-semblance toujours soutenüe, & capable de lui faire oublier que c'est sur une fiction que notre cœur s'attendrit. Ils ont mis en œuvre les beautez d'exécution, afin de nous prevenir en faveur de leurs personnages, par l'élégance de l'extérieur, ou par l'agrément du langage. Ils ont voulu arrêter nos sens sur les objets destinés à toucher notre ame.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Or il faut être né avec du génie pour inventer, & l'on ne parvient même qu'à l'aide d'une longue étude à bien inventer. Un homme qui invente mal, qui produit sans jugement, ne mérite pas le nom d'Inventeur. [...] Les regles qui sont déja réduites en méthode, sont des guides qui ne montrent le chemin que de loin, & ce n'est qu'avec le secours de l'expérience, que les génies les plus heureux apprennent d'elles comment il faut appliquer dans la pratique leurs maximes succinctes & leurs préceptes trop géneraux. Soïez toujours pathétiques, disent ces regles, & ne laissez lamais languir vos spectateurs, ni vos auditeurs.
Si cet enthousiasme divin, qui rend les Peintres Poëtes, & les Poëtes Peintres, manque à nos Artisans, s'ils n'ont pas, comme le dit Monsieur Perrault (a),
ce feu, cette divine flâme,
l'Esprit de notre esprit, & l'Ame de notre ame.
les uns & les autres restent toute leur vie de vils ouvriers, & des manœuvres, dont il faut païer les journées, mais qui ne méritent pas la consideration & les récompenses que les Nations polies doivent aux Artisans illustres. Ils sont de ces gens dont Ciceron dit : (b) Quorum opera non quorum artes emuntur. Ce qu'ils sçavent de leur profession, n'est qu'une routine qui se peut apprendre comme on apprend les autres métiers. Les esprits les plus communs, sont capables d'être des Peintres & des Poëtes médiocres.On appelle génie, l'aptitude qu'un homme a reçu de la nature, pour faire bien & facilement certaines choses, que les autres ne sçauroient faire que très-mal, même en prenant beaucoup de peine. Nous apprenons à faire les choses pour lesquelles nous avons du génie, avec autant de facilité que nous en avons à parler notre langue naturelle.
(a) Êpitre du génie à M. Fontenelle
(b) De Officiis lib. prim.
Il semble même que la providence n'ait voulu rendre certains talens & certaines inclinations plus communes parmi un certain peuple que parmi d'autres peuples, qu'afin de mettre entre les Nations la dépendance réciproque qu'elle a pris tant de soin d'établir entre les particuliers. Les besoins qui engagent les particuliers d'entrer en societé les uns avec les autres, engagent aussi les Nations à lier entre elles une societé. La Providence a donc voulu que les nations fussent obligées de faire les unes avec les autres, un échange de talens & d'industrie, comme elles font échange des fruits differens de leurs païs, afin qu'elles se recherchassent réciproquement, par le même motif qui fait que les particuliers se joignent ensemble pour composer un même peuple : le desir d'être bien, ou l'envie d'être mieux.
De la difference des génies, naît la diversité des inclinations des hommes, que la nature a pris la précaution de porter aux emplois, pour lesquels elles les destine, avec plus ou moins d'impétuosité, suivant qu'ils doivent avoir plus ou moins d'obstacles à surmonter, pour se rendre capables de remplir cette vocation. Les inclinations des hommes ne sont si differentes que parce qu'ils suivent tous le même mobile, je veux dire l'impulsion de leur génie.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Il semble même que la providence n'ait voulu rendre certains talens & certaines inclinations plus communes parmi un certain peuple que parmi d'autres peuples, qu'afin de mettre entre les Nations la dépendance réciproque qu'elle a pris tant de soin d'établir entre les particuliers. Les besoins qui engagent les particuliers d'entrer en societé les uns avec les autres, engagent aussi les Nations à lier entre elles une societé. La Providence a donc voulu que les nations fussent obligées de faire les unes avec les autres, un échange de talens & d'industrie, comme elles font échange des fruits differens de leurs païs, afin qu'elles se recherchassent réciproquement, par le même motif qui fait que les particuliers se joignent ensemble pour composer un même peuple : le desir d'être bien, ou l'envie d'être mieux.
De la difference des génies, naît la diversité des inclinations des hommes, que la nature a pris la précaution de porter aux emplois, pour lesquels elles les destine, avec plus ou moins d'impétuosité, suivant qu'ils doivent avoir plus ou moins d'obstacles à surmonter, pour se rendre capables de remplir cette vocation. Les inclinations des hommes ne sont si differentes que parce qu'ils suivent tous le même mobile, je veux dire l'impulsion de leur génie.
Génie et talent sont liés au déterminisme climatique ; ils dépendent du lieu de naissance de l'artiste
Conceptual field(s)
Je conçois que le génie de leurs Arts (ndr. : Peintres et Poëtes) consiste dans un arrangement heureux de leur cerveau, dans la bonne conformation de chacun de ces organes, comme dans la qualité du sang, laquelle le dispose à fermenter durant le travail, de manière qu'il fournisse en abondance des esprit aux ressorts qui servent aux fonctions de l'imagination. En effet l'extrême lassitude & l'épuisement, qui suivent une longue contention d'esprit rendent sensible que les travaux d'imagination font une grande dissipation des forces du corps. J'ai supposé que le sang de celui qui compose, s'échauffât ; car les Peintres & les Poëtes ne peuvent inventer se sang froid : on sçait bien qu'ils entrent en une espece d'enthousiasme. […]
Mais la fermentation du sang la plus heureuse ne produira que des chimeres bizarres dans un cerveau composé d'organes vicieux ou mal disposez, & par conséquent incapables de représenter au Poëte la nature, telle qu'elle paroît aux autres hommes. Les copies qu'il fait de la nature, ne ressemblent point, parce que son miroir n'est pas fidele, pour ainsi dire. […]
D'un autre côté, si ce feu qui provient d'un sang chaud & rempli d'esprits, manque en un cerveau bien disposé, ses productions seront régulières, mais elles seront froides. […]
Si le feu poëtique l'anime quelque fois, il s'éteint bien-tôt, & il ne jette que des lueurs. […]
Lorsque la qualité du sang est jointe avec l'heureuse disposition des organes, ce concours favorable forme, à ce que j'imagine, le génie poëtique ou pittoresque ; car je me défie des explications physiques, attendu l'imperfection de cette science dans laquelle il faut presque toujours deviner. Mais les faits que j'explique sont certains, & ces faits, quoique nous n'en concevions pas bien la raison, suffisent pour appuïer mon systême.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Le génie est ce feu qui éleve les Peintres au-dessus d'eux-mêmes, qui leur fait mettre de l'ame dans leurs figures, & du mouvement dans leurs compositions
[…] L'expérience prouve suffisamment que tous les hommes ne naissent pas avec un génie propre à les rendre Peintre ou Poëtes : nous en voïons qu'un travail continué durant plusieurs années, plutôt avec obstination qu'avec persévérance, n'a pû élever au-dessus du rang de simples versificateurs. Nous avons vu de même, des hommes d'esprit, qui avoient copié plusieurs fois ce que la peinture a produit de plus sublime, vieillir le pinceau & la palette à la main, sans s'élever au-dessus du rang de Coloristes médiocres, & de serviles Dessinateurs d'après les figures d'autrui.
Conceptual field(s)
La mécanique de la Peinture est très-pénible, mais elle n'est pas rebutante pour ceux qui sont nez avec le génie de l'art. Ils sont soutenus contre le dégoût par l'attrait d'une profession à laquelle ils se sentent propres, & par le progrès sensible qu'ils font dans leurs études. Les Eleves trouvent encore partout des Maîtres qui leur abregent le chemin. Que ces Maîtres soient de grands hommes ou des ouvriers médiocres, il n'importe, l'Eleve qui aura du génie, profitera toujours de leurs enseignements. Il lui suffit que ces Maîtres lui puissent enseigner une pratique, qu'on ne sçauroit ignorer, quand on a professé cet art durant dix ou douze années. Un Eleve qui a du génie, apprend à bien faire, en voïant son Maître faire mal. La force du génie change en bonne nourriture les préceptes les plus mal digerez. Ce qu'un homme né avec du génie, fait de mieux, est ce que personne ne lui a montré à faire. […]
CARRACCI, Annibale
LE BRUN, Charles
PERUGINO, Pietro (Pietro di Cristoforo Vannucci)
POUSSIN, Nicolas
RUBENS, Peter Paul
SENECA
Conceptual field(s)
CARRACCI, Annibale
LE BRUN, Charles
PERUGINO, Pietro (Pietro di Cristoforo Vannucci)
POUSSIN, Nicolas
RUBENS, Peter Paul
SENECA
Conceptual field(s)
CARRACCI, Annibale
LE BRUN, Charles
PERUGINO, Pietro (Pietro di Cristoforo Vannucci)
POUSSIN, Nicolas
RUBENS, Peter Paul
SENECA
Conceptual field(s)
Le génie ne se borne pas à une simple sollicitation, pour obliger celui qui l'a reçu à se produire. Le génie ne se rebute point, parce que ses premieres impulsions n'auroient pas eu d'effet: il presse avec persévérance, & il sçait enfin se faire jour à travers l'inapplication & la dissipation de la jeunesse.
Tout devient palettes & pinceaux entre les mains d'un enfant doüé du génie de la Peinture. Ils fait connoître aux autres pour ce qu'il est, quand lui-même ne le sçait pas encore. Les Annalistes de la Peinture rapportent une infinité de faits qui confirment ce que j'avance. La plûpart des grands Peintres ne sont pas nez dans les atteliers. Très-peu sont des fils de Peintres, qui, suivant l'usage ordinaire, auroient été élevez dans la profession de leurs peres. Parmi les Artisans illustres qui font tant d'honneur aux deux derniers siècles, le seul Raphaël, autant qu'il m'en souvient, fut le fils d'un Peintre. Le pere du Georgeon & celui du Titien, ne manierent jamais ni pinceaux ni cizeaux, Leonard De Vinci, & Paul Veronése, n'eurent point de Peintres pour peres. Les parens de Michel-Ange vivoient, comme on dit, noblement, c'est-à-dire, sans exercer aucune profession lucrative. André Del Sarte étoit fils d'un Tailleur, & Le Tintoret d'un Tinturier. Le pere des Caraches, n'étoit pas d'une profession où l'on manie le craïon. Michel-Ange De Caravage étoit fils d'un Masson, & Le Correge fils d'un Laboureur. Le Guide étoit fils d'un Musicien, Le Dominiquin d'un Cordonnier, & L'Albane d'un Marchand de Soïe. Lanfranc étoit un enfant trouvé, à qui son génie enseigna la peinture, à peu près comme le génie de M Pascal lui enseigna les Mathématiques. Le pere de Rubens, qui étoit dans la Magistrature d'Anvers, n'avoit ni attelier ni boutique dans sa maison. Le pere de Vandick n'étoit ni Peintre ni Sculpteur. Du Fresnoy, dont nous avons un poëme sur la Peinture, qui a mérité d'être traduit & commenté par M. De Piles, & dont nous avons aussi des tableaux au-dessus du médiocre, avoit étudié pour être Médecin. Les peres des quatre meilleurs Peintres François du dernier siècle, Le Valentin, Le Sueur, Le Poussin & Le Brun, n'étoient pas des peintres. C'est le génie de ces grands hommes qui les a été chercher, pour ainsi dire, dans la maison de leurs parens, afin de les conduire sur le Parnasse. Les Peintres montent sur le Parnasse, aussi-bien que les Poëtes.
Les peintres dotés de génie ne l'ont pas hérité de leur père.
Conceptual field(s)
Les peintres dotés de génie ne l'ont pas hérité de leur père.
Conceptual field(s)
Les peintres dotés de génie ne l'ont pas hérité de leur père.
Conceptual field(s)
Mathématiques.
ALBANI, Francesco
CARAVAGGIO (Michelangelo Merisi da Caravaggio)
CARRACCI, les
DA VINCI, Leonardo
DEL SARTO, Andrea
DE PILES, Roger
DU FRESNOY, Charles-Alphonse
GIORGIONE (Giorgio da Castelfranco)
IL CORREGGIO (Antonio Allegri)
IL DOMENICHINO (Domenico Zampieri)
IL TINTORETTO (Jacopo Robusti)
LE BRUN, Charles
LE SUEUR, Eustache
LE VALENTIN (Valentin de Boulogne)
MICHELANGELO (Michelangelo Buonarroti)
PASCAL, Blaise
POUSSIN, Nicolas
RAFFAELLO (Raffaello Sanzio)
RENI, Guido
RUBENS, Peter Paul
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
VAN DYCK, Antoon
VERONESE, Paolo (Paolo Caliari)
Les peintres dotés de génie ne l'ont pas hérité de leur père.
Conceptual field(s)
Le génie est donc une plante, qui, pour ainsi dire, pousse d'elle-même ; mais la qualité, comme la quantité de ses fruits, dépendent beaucoup de la culture qu'elle reçoit. Le génie le plus heureux, ne peut être perfectionné qu'à l'aide d'une longue étude. [...]
Mais un homme né avec du génie, est bien-tôt capable d'étudier tout seul, & c'est l'étude qu'il fait par son choix, & déterminé par son goût, qui contribuë le plus à le former. Cette étude consiste dans une attention continuelle sur la nature. Elle consiste dans une réflexion sérieuse sur les ouvrages des grands maîtres, suivie d'observations sur ce qu'il convient d'imiter, & sur ce qu'il faudroit tâcher de surpasser. Ces observations nous enseignent beaucoup de choses, que notre génie ne nous auroit jamais suggerées de lui-même, ou dont il ne se seroit avisé que bien tard. On se rend propre en un jour des tours & des façons d'operer, qui coûterent aux inventeurs des années de recherche & de travail. En supposant même que notre génie auroit eu la force de nous porter un jour jusques-là, quoique la route n'eut pas été fraïée, nous n'y serions parvenus du moins, avec le seul secours de ses forces, qu'au prix d'une fatigue pareille à celle des Inventeurs.
Conceptual field(s)
Le génie est donc une plante, qui, pour ainsi dire, pousse d'elle-même ; mais la qualité, comme la quantité de ses fruits, dépendent beaucoup de la culture qu'elle reçoit. Le génie le plus heureux, ne peut être perfectionné qu'à l'aide d'une longue étude. [...]
Mais un homme né avec du génie, est bien-tôt capable d'étudier tout seul, & c'est l'étude qu'il fait par son choix, & déterminé par son goût, qui contribuë le plus à le former. Cette étude consiste dans une attention continuelle sur la nature. Elle consiste dans une réflexion sérieuse sur les ouvrages des grands maîtres, suivie d'observations sur ce qu'il convient d'imiter, & sur ce qu'il faudroit tâcher de surpasser. Ces observations nous enseignent beaucoup de choses, que notre génie ne nous auroit jamais suggerées de lui-même, ou dont il ne se seroit avisé que bien tard. On se rend propre en un jour des tours & des façons d'operer, qui coûterent aux inventeurs des années de recherche & de travail. En supposant même que notre génie auroit eu la force de nous porter un jour jusques-là, quoique la route n'eut pas été fraïée, nous n'y serions parvenus du moins, avec le seul secours de ses forces, qu'au prix d'une fatigue pareille à celle des Inventeurs.
Conceptual field(s)
Je ne dis point pour cela qu'il faille prendre mauvaise augure la critique d'un jeune Artisan qui remarque des défauts dans les ouvrages des grands maîtres : il y en a véritablement, car ils étoient des hommes. Le génie, loin d'empêcher qu'on ne voïe ces fautes, les fait même apercevoir. Ce que je regarde comme un mauvais présage, c'est qu'un jeune homme soit peu touché de l'excellence des productions des grands maîtres : c'est qu'il n'entre point dans un espece d'enthousiasme en les lisant : c'est qu'il ait besoin, pour connoître s'il doit les estimer, de calculer les beautez & les défauts qu'il y compte, & qu'il ne forme son avis sur le mérite, qu'après avoir soudé son calcul. S'il avoit la vivacité & la délicatesse de sentiment, qui sont inséparables du génie, il seroit reellement saisi par les beautez des ouvrages consacrez, qu'il jetteroit sa balance & son compas pour en juger, ainsi que les hommes en ont toujours jugé, je veux dire par l'impression que ces ouvrages feroient sur lui.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Le génie se fait sentir bien-tôt dans les ouvrages des jeunes gens qui en sont doüez, ils donnent à connoître qu'ils ont du génie, dans un temps où ils ne sçavent point encore la pratique de leur art. On voit dans leurs ouvrages des idées & des expressions qu'on n'a point vûës encore. On y voit des pensées nouvelles. On y remarque à travers bien des défauts, un esprit qui veut atteindre à de grandes beautez, & qui, pour y parvenir, fait des choses que son maître n'a point été capable de lui enseigner. [...]
Le jeune Peintre qui a du génie, commence donc bien-tôt à s’écarter de son maître, dans les choses où le maître s’écarte de la nature. Ses yeux, à peine entr’ouverts, la découvrent déjà. Souvent il la voit mieux que ceux qui prétendent la lui montrer.
Conceptual field(s)
Ces esprits médiocrement propres à beaucoup de choses, ont la même destinée, quand on les applique à la Peinture. Un homme de cette trempe, que les conjonctures engagent à se faire Peintre, imite servilement plutôt qu'exactement, le goût de son maître dans les contours & dans le coloris. Il devient un dessinateur correct, s'il ne devient pas un dessinateur élégant, & si l'on ne sçauroit loüer l'excellence de son coloris, du moins n'y remarque-t'on pas de fautes grossieres contre la vérité ; il est des regles pour n'en point faire : mais comme les regles ne peuvent enseigner qu'aux personnes de génie à réussir dans l'ordonnance & dans la composition poëtique, ses tableaux, ses tableaux sont très-défectueux dans ce deux parties. Ses ouvrages ne sont beaux que par endroits, parce que n'aïant pas imaginé tout son plan, mais l'aïant fait seulement piece à pièce, rien n'y est ensemble.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
C'est en vain qu'un pareil sujet fait son apprentissage sous le meilleur maître, il ne sçauroit faire dans une pareille école les mêmes progrès qu'un homme de génie fait dans l'école d'un maître médiocre. Celui qui enseigne, comme le dit Quintilien, ne sçauroit communiquer à son disciple le talent de produire & l'art d'inventer, qui font le plus grand mérite des Peintres & des Orateurs. [...] Le Peintre peut donc faire part des secrets de sa pratique, mais il ne sçauroit faire part de ses talens pour la composition & pour l'expression. Souvent même l'Eleve dépourvu du génie, ne peut atteindre la perfection où son maître est parvenu dans la mécanique de l'art. L'imitateur servile doit demeurer au-dessous de son modele, parce qu'il joint ses propres défauts aux défauts de celui qu'il imite. D'ailleurs si le maître est homme de génie, il se dégoûte bien-tôt d'enseigner un pareil sujet. Il est au supplice quand il voit que son éleve n'entend qu'avec peine ce qu'il comprenoit d'abord, lorsque lui-même il étoit Eleve. [...]
On ne trouve rien de nouveau dans les compositions des peintres sans génie, on ne voit rien de singulier dans leurs expressions. Ils sont si stériles qu'après avoir long-temps copié les autres, ils en viennent enfin à se copier eux-mêmes ; & quand on sçait le tableau qu'ils ont promis, on devine la plus grande partie des figures de l'ouvrage.
C'est en vain qu'un pareil sujet fait son apprentissage sous le meilleur maître, il ne sçauroit faire dans une pareille école les mêmes progrès qu'un homme de génie fait dans l'école d'un maître médiocre. Celui qui enseigne, comme le dit Quintilien, ne sçauroit communiquer à son disciple le talent de produire & l'art d'inventer, qui font le plus grand mérite des Peintres & des Orateurs. [...] Le Peintre peut donc faire part des secrets de sa pratique, mais il ne sçauroit faire part de ses talens pour la composition & pour l'expression. Souvent même l'Eleve dépourvu du génie, ne peut atteindre la perfection où son maître est parvenu dans la mécanique de l'art. L'imitateur servile doit demeurer au-dessous de son modele, parce qu'il joint ses propres défauts aux défauts de celui qu'il imite. D'ailleurs si le maître est homme de génie, il se dégoûte bien-tôt d'enseigner un pareil sujet. Il est au supplice quand il voit que son éleve n'entend qu'avec peine ce qu'il comprenoit d'abord, lorsque lui-même il étoit Eleve. [...]
On ne trouve rien de nouveau dans les compositions des peintres sans génie, on ne voit rien de singulier dans leurs expressions. Ils sont si stériles qu'après avoir long-temps copié les autres, ils en viennent enfin à se copier eux-mêmes ; & quand on sçait le tableau qu'ils ont promis, on devine la plus grande partie des figures de l'ouvrage.
L'habitude d'imiter les autres, nous conduit à nous copier nous-mêmes. L'idée de ce que nous avons peint, est toujours plus présente à notre esprit que l'idée de ce qu'ont peint les autres. C'est la première qui s'offre aux Peintres qui cherchent la composition, & les figures des tableaux qu'ils ont entrepris plutôt dans leur mémoire que dans leur imagination. Les uns, comme le Bassan, se livrent de bonne foi à une répétition sincere de leurs ouvrages. Les autres, en voulant cacher les larcins qu'ils se font à eux-mêmes, reproduisent sur la Scene leur personnages déguisez, mais non pas méconnaissables, & ils rendent ainsi leurs larçins encore plus odieux. […]
Conceptual field(s)
Je comparerois volontiers ce superbe étalage de chef-d’œuvres anciens & modernes, qui rendent Rome la plus auguste ville de l'univers, à ces boutiques où l'on étale une grande quantité de pierreries. En quelque profusion que les pierreries y soient étalées, on n'en rapporte chez soi qu'à proportion de l'argent qu'on avoit porté pour faire son emplette. Ainsi l'on ne profite solidement de tous les chef-d’œuvres de Rome, qu'à proportion du génie avec lequel on les regarde. Le Sueur, qui n'avoit jamais été à Rome, & qui n'avoit vû que de loin, c'est-à-dire, dans des copies, les richesses de cette capitale des beaux arts, en avoit mieux profité, que beaucoup de Peintres qui se glorifioient d'un séjour de plusieurs années au pied du Capitole. De même un jeune Poëte ne profite de la lecture de Virgile & d'Horace qu'à proportion des lumieres de son génie, à la clarté desquelles il étudie les anciens, pour ainsi dire.
Je comparerois volontiers ce superbe étalage de chef-d’œuvres anciens & modernes, qui rendent Rome la plus auguste ville de l'univers, à ces boutiques où l'on étale une grande quantité de pierreries. En quelque profusion que les pierreries y soient étalées, on n'en rapporte chez soi qu'à proportion de l'argent qu'on avoit porté pour faire son emplette. Ainsi l'on ne profite solidement de tous les chef-d’œuvres de Rome, qu'à proportion du génie avec lequel on les regarde. Le Sueur, qui n'avoit jamais été à Rome, & qui n'avoit vû que de loin, c'est-à-dire, dans des copies, les richesses de cette capitale des beaux arts, en avoit mieux profité, que beaucoup de Peintres qui se glorifioient d'un séjour de plusieurs années au pied du Capitole. De même un jeune Poëte ne profite de la lecture de Virgile & d'Horace qu'à proportion des lumieres de son génie, à la clarté desquelles il étudie les anciens, pour ainsi dire.
Conceptual field(s)
Ceux des Peintres qui ont excellé à peindre l'ame des hommes, & à bien exprimer toutes les passions, ont été des Coloristes médiocres. D'autres ont fait circuler le sang dans la chair de leurs figures ; mais ils n'ont pas sçu l'art des expressions aussi-bien que les Ouvriers médiocres de l'Ecole romaine. Nous avons vu plusieurs Peintres Hollandois, doüez de génie pour la mécanique de leur art, & surtout d’un talent merveilleux pour imiter les effets du clair-obscur dans un petit espace renfermé, talent, dont ils avoient l'obligation à une patience d'esprit singuliere, laquelle leur permettoit de se clouer long-temps sur un même ouvrage, sans être dégoûtez par ce dépit qui s'excite dans les hommes d'un temperament plus vif, quand ils voïent leurs efforts avorter plusieurs fois de suite. Ces Peintres flegmatiques ont donc eu la persévérance de chercher par un nombre infini de tentatives, souvent réïterées sans fruit, les teintes, les demi-teintes, enfin toutes les diminutions de couleurs nécessaires pour dégrader la couleur des objets, & ils sont ainsi parvenus à peindre la lumiere même. On est enchanté par la magie de leur clair-obscur. Les nuances ne sont pas mieux fonduës dans la nature que dans leurs tableaux. Mais ces Peintres ont mal réussi dans les autres parties de l'art, qui ne sont pas les moins importantes. Sans invention dans leurs expressions : incapables de s'élever au-dessus de la nature qu'ils avoient devant les yeux, ils n'ont peint que des passions basses & une nature ignoble. La Scene de leurs tableaux est une boutique, un corps de garde, ou la cuisine d'un païsan : leurs heros sont des faquins. Ceux des Peintres Hollandois, dont je parle, qui ont osé faire des tableaux d'histoire, ont peint des ouvrages admirables pour le clair-obscur, mais ridicules pour le reste. Les vêtemens de leurs personnages sont extravagans, & les expressions de ces personnages sont encore basses & comiques. Ces Peintres peignent Ulisse sans finesse, Susanne sans pudeur, & Scipion sans aucun trait de noblesse ni de courage. Le pinceau de ces froids Artisans, fait perdre à toutes les têtes illustres leur caractere connu. Nos Hollandois, au nombre desquels on voit bien que je ne comprens pas ici les peintres de l'école d'Anvers, ont bien connu la valeur des couleurs locales, mais ils n'en ont pas sçû tirer le même avantage que les peintres de l'école venitienne. Le talent de colorier, comme l'a fait Le Titien, demande de l'invention, & il dépend plus d'une imagination fertile en expedients pour le mêlange des couleurs, que d'une perséverance opiniâtre à refaire dix fois la même chose.
[...]
École d'Anvers
École hollandaise
École romaine
École vénitienne
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
École d'Anvers
École hollandaise
École romaine
École vénitienne
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
École d'Anvers
École hollandaise
École romaine
École vénitienne
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
École d'Anvers
École hollandaise
École romaine
École vénitienne
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
On appelle pastiches les tableaux que fait un Peintre imposteur, en imitant la main, la manière de composer & le coloris d'un autre Peintre, sous le nom duquel il veut produire son propre ouvrage.
Conceptual field(s)
Il est donc également important aux nobles Artisans, dont je parle, de connoître à quel genre de poësie & de peinture leurs talens les destinent, & de se borner au genre pour lequel ils sont nez propres. L'art ne sçauroit faire autre chose que de perfectionner l'aptitude ou le talent que nous avons apporté en naissant ; mais l'art ne sçauroit nous donner le talent que la nature nous a refusé. L'art ajoûte beaucoup aux talens naturels, mais c'est quand on étudie un art pour lequel on est né. [...] Tel Peintre demeure confondu dans la foule qui seroit au rang des Peintres illustres, s'il ne se fût point laissé entraîner par une émulation aveugle, qui lui a fait entreprendre de se rendre habile dans des genres de la Peinture, pour lesquels il n'étoit point né, & qui lui a fait négliger les genres de la peinture ausquels il étoit propre. Les ouvrages qu'il a tenté de faire sont, si l'on veut, d'une classe supérieure. Mais ne vaut-il pas mieux être un des premiers parmi les Païsagistes que le dernier des peintres d'histoire ? Ne vaut-il pas mieux être cité pour un des premiers faiseurs de portraits de son temps, que pour un miserable arrangeur de figures ignobles & estropiées.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
L'émulation & l'étude ne sçauroient donner à un génie la force de franchir les limites que la nature a prescrites à son activité. Le travail peut bien le perfectionner, mais je doute qu'il puisse lui donner réellement plus d'étenduë qu'il n'en a. L'étenduë que le travail semble donner aux génies, n'est qu'une étenduë apparente. L'art enseigne à cacher leurs bornes, mais il ne les recule pas.[…] Ainsi le travail & l'expérience font bien faire aux Peintres, comme aux Poëtes, des ouvrages plus corrects, mais ils ne sçauroient leur en faire produire de plus sublimes. Ils ne sçauroient leur faire enfanter des ouvrages d'un caractère élevé au-dessus de leur portée naturelle
Conceptual field(s)
Section VIII. Des Plagiaires. En quoi ils different de ceux qui mettent leurs études à profit. p. 78
Ce qui constituë le Plagiaire, c'est de donner l'ouvrage d'autrui comme son propre ouvrage.
Conceptual field(s)
Section VIII. Des Plagiaires. En quoi ils different de ceux qui mettent leurs études à profit. p. 85
Comme les Peintres parlent tous, pour ainsi dire, la même langue, ils ne peuvent pas emploïer les traits célebres, dont un autre Peintre s'est déjà servi, lorsque les ouvrages de ce Peintre subsistent encore. Le Poussin a pû se servir de l'idée du Peintre Grec qui avoit présenté Agamemnon la tête voilée au sacrifice d'Iphigénie, pour mieux donner à comprendre à l'excès de la douleur du pere de la victime. Le Poussin a pû se servir de ce trait pour exprimer la même chose, en réprésentant Agrippine qui se cache le visage avec les mains dans le tableau de la mort de Germanicus. Le tableau du Peintre grec ne subsistoit plus, quand le peintre François fit le sien. Mais le Poussin auroit été blâmé d'avoir volé ce trait, s'il se fût trouvé dans un tableau, ou de Raphaël, ou de Carrache.
Comme il n'y a point de mérite à dérober une tête à Raphaël ou une figure au Dominiquin ; comme le larcin se fait sans grand travail, il est défendu sous peine du mépris public. Mais comme il faut du talent et du travail pour animer le marbre d'une figure antique, & pour faire d'une statue un personnage vivant, & qui concourre à une action avec d'autres personnages, on est loué de l'avoir fait. […]
Il y a bien de la difference entre emporter d'une gallerie l'art du peintre, entre se rendre propre la maniere d'operer de l'Artisan qu'on vient d'admirer, & remporter dans son portefeüille une partie de ses figures. Un homme sans génie n'est point capable de convertir en sa propre substance, comme le fit Raphaël, ce qu'on y remarque de grand & de singulier. Sans saisir les principes géneraux, il se contente de copier ce qu'il a dessous les yeux. Il emportera donc une des figures, mais il n'apprendra point à traiter dans le même goût une figure qui seroit de son invention. L'homme de génie devine comment l'ouvrier a fait. Il le voit travailler, pour ainsi dire, en regardant son ouvrage & saisissant sa maniere, c'est dans l'imagination qu'il remporte son butin.
ANONYME, Apollon du Belvédère, v. 130 - v. 140, marbre, h. 224, Vatican, Vatican, Museo Pio-Clementino, inv. 1015.
POUSSIN, Nicolas, La Mort de Germanicus, 1627, huile sur toile, 148 x 198, Etats-Unis, The William Hood Dunwoody Fund 58.28.
Conceptual field(s)
Section VIII. Des Plagiaires. En quoi ils different de ceux qui mettent leurs études à profit. p. 85
Comme les Peintres parlent tous, pour ainsi dire, la même langue, ils ne peuvent pas emploïer les traits célebres, dont un autre Peintre s'est déjà servi, lorsque les ouvrages de ce Peintre subsistent encore. Le Poussin a pû se servir de l'idée du Peintre Grec qui avoit présenté Agamemnon la tête voilée au sacrifice d'Iphigénie, pour mieux donner à comprendre à l'excès de la douleur du pere de la victime. Le Poussin a pû se servir de ce trait pour exprimer la même chose, en réprésentant Agrippine qui se cache le visage avec les mains dans le tableau de la mort de Germanicus. Le tableau du Peintre grec ne subsistoit plus, quand le peintre François fit le sien. Mais le Poussin auroit été blâmé d'avoir volé ce trait, s'il se fût trouvé dans un tableau, ou de Raphaël, ou de Carrache.
Comme il n'y a point de mérite à dérober une tête à Raphaël ou une figure au Dominiquin ; comme le larcin se fait sans grand travail, il est défendu sous peine du mépris public. Mais comme il faut du talent et du travail pour animer le marbre d'une figure antique, & pour faire d'une statue un personnage vivant, & qui concourre à une action avec d'autres personnages, on est loué de l'avoir fait. […]
Il y a bien de la difference entre emporter d'une gallerie l'art du peintre, entre se rendre propre la maniere d'operer de l'Artisan qu'on vient d'admirer, & remporter dans son portefeüille une partie de ses figures. Un homme sans génie n'est point capable de convertir en sa propre substance, comme le fit Raphaël, ce qu'on y remarque de grand & de singulier. Sans saisir les principes géneraux, il se contente de copier ce qu'il a dessous les yeux. Il emportera donc une des figures, mais il n'apprendra point à traiter dans le même goût une figure qui seroit de son invention. L'homme de génie devine comment l'ouvrier a fait. Il le voit travailler, pour ainsi dire, en regardant son ouvrage & saisissant sa maniere, c'est dans l'imagination qu'il remporte son butin.
ANONYME, Apollon du Belvédère, v. 130 - v. 140, marbre, h. 224, Vatican, Vatican, Museo Pio-Clementino, inv. 1015.
POUSSIN, Nicolas, La Mort de Germanicus, 1627, huile sur toile, 148 x 198, Etats-Unis, The William Hood Dunwoody Fund 58.28.
Conceptual field(s)
Comme il n'y a point de mérite à dérober une tête à Raphaël ou une figure au Dominiquin ; comme le larcin se fait sans grand travail, il est défendu sous peine du mépris public. Mais comme il faut du talent et du travail pour animer le marbre d'une figure antique, & pour faire d'une statue un personnage vivant, & qui concourre à une action avec d'autres personnages, on est loué de l'avoir fait. […]
Il y a bien de la difference entre emporter d'une gallerie l'art du peintre, entre se rendre propre la maniere d'operer de l'Artisan qu'on vient d'admirer, & remporter dans son portefeüille une partie de ses figures. Un homme sans génie n'est point capable de convertir en sa propre substance, comme le fit Raphaël, ce qu'on y remarque de grand & de singulier. Sans saisir les principes géneraux, il se contente de copier ce qu'il a dessous les yeux. Il emportera donc une des figures, mais il n'apprendra point à traiter dans le même goût une figure qui seroit de son invention. L'homme de génie devine comment l'ouvrier a fait. Il le voit travailler, pour ainsi dire, en regardant son ouvrage & saisissant sa maniere, c'est dans l'imagination qu'il remporte son butin.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Les génies les plus heureux ne naissent pas de grands Artisans. Ils naissent seulement capables de le devenir. Ce n'est qu'à force de travail qu'ils s'élevent au point de perfection qu'ils peuvent atteindre.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Les génies les plus heureux ne naissent pas de grands Artisans. Ils naissent seulement capables de le devenir. Ce n'est qu'à force de travail qu'ils s'élevent au point de perfection qu'ils peuvent atteindre.
Conceptual field(s)
Au lieu que les Artisans sans génie, qui sont aussi propres à être les Eleves du Poussin que du Titien, demeurent durant toute leur vie dans la route où le hazard les peut avoir engagez, les Artisans doüez de génie, s'apperçoivent, quand le hazard les égare, que la route qu'ils ont prise n'est point celle qui leur convient. Ils l'abandonnent pour en prendre une autre ; ils quittent celle de leur maître pour s'en faire une nouvelle. Par maître, j'entends ici les ouvrages aussi bien que les personnes.Raphaël, mort depuis deux cens ans, peut encore faire des Eleves. Notre jeune Artisan, doüé de génie, se forme donc lui-même une pratique pour imiter la nature, & il forme cette pratique des maximes résultantes de la réflexion qu'il fait sur son travail & sur le travail des autres. Chaque jour ajoûte ainsi de nouvelles lumieres à celles qu'il avoit acquises précedemment. […] Le génie est dans les hommes, ce qui vieillit le dernier. […] Plusieurs témoins oculaires m'ont raconté, que le Poussin avoit été jusques à la fin de sa vie un jeune Peintre du côté de l'imagination. Son mérite avoit survécu à la dextérité de sa main, & il inventoit encore, quand il n'avoit plus les talens nécessaires à l'exécution de ses inventions.
Un jeune homme ne sçauroit faire dans l'art de la Peinture tout le progrès dont il est capable, si sa main ne se perfectionne pas en même-temps que son imagination. Il ne suffit pas aux Peintres de concevoir des idées nobles, d'imaginer les compositions les plus élegantes, & de trouver les expressions les plus pathétiques, il faut encore que leur main ait été renduë docile à se fléchir avec précision en cent manieres differentes, pour se trouver capable de tirer avec justesse la ligne que l'imagination lui demande. Nous ne sçaurions faire rien de bien, dit Du Fresnoi, dans son Poëme de la Peinture, si notre main n'est pas capable de mettre sur la toile les beautez que notre esprit produit. [...] Le génie a, pour ainsi dire, les bras liez dans un Artisan, dont la main n'est pas dénoüée. Il en est de l'œil comme de la main. Il faut que l'œil d'un Peintre soit accoutumé de bonne heure à juger par une operation sûre & facile en même-temps, quel effet doit faire un certain mêlange, ou bien une certaine opposition de couleur, quel effet doit faire une figure d'une certaine hauteur dans un Grouppe ; & quel effet un certain Grouppe fera dans le tableau, après que le tableau sera colorié. Si l'imagination n'a pas à sa disposition une main & un œil capables de la seconder à son gré, il ne résulte des plus belles idées qu'enfante l'imagination, qu'un tableau grossier, & que dédaigne l'Artisan même qui l'a peint, tant il trouve l'œuvre de sa main au-dessous de l'œuvre de son esprit.
L'étude nécessaire pour perfectionner l'œil & la main, ne se fait point en donnant quelques heures distraites à un travail interrompu. Cette étude demande une attention entiere & une perséverance continuée durant plusieurs années. […]
Le seul tems de la vie qui soit bien propre à faire acquerir leur perfection à l'œil et à la main, est le tems où nos organes, tant intérieurs qu'extérieurs, achevent.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Un jeune homme ne sçauroit faire dans l'art de la Peinture tout le progrès dont il est capable, si sa main ne se perfectionne pas en même-temps que son imagination. Il ne suffit pas aux Peintres de concevoir des idées nobles, d'imaginer les compositions les plus élegantes, & de trouver les expressions les plus pathétiques, il faut encore que leur main ait été renduë docile à se fléchir avec précision en cent manieres differentes, pour se trouver capable de tirer avec justesse la ligne que l'imagination lui demande. Nous ne sçaurions faire rien de bien, dit Du Fresnoi, dans son Poëme de la Peinture, si notre main n'est pas capable de mettre sur la toile les beautez que notre esprit produit. [...] Le génie a, pour ainsi dire, les bras liez dans un Artisan, dont la main n'est pas dénoüée. Il en est de l'œil comme de la main. Il faut que l'œil d'un Peintre soit accoutumé de bonne heure à juger par une operation sûre & facile en même-temps, quel effet doit faire un certain mêlange, ou bien une certaine opposition de couleur, quel effet doit faire une figure d'une certaine hauteur dans un Grouppe ; & quel effet un certain Grouppe fera dans le tableau, après que le tableau sera colorié. Si l'imagination n'a pas à sa disposition une main & un œil capables de la seconder à son gré, il ne résulte des plus belles idées qu'enfante l'imagination, qu'un tableau grossier, & que dédaigne l'Artisan même qui l'a peint, tant il trouve l'œuvre de sa main au-dessous de l'œuvre de son esprit.
L'étude nécessaire pour perfectionner l'œil & la main, ne se fait point en donnant quelques heures distraites à un travail interrompu. Cette étude demande une attention entiere & une perséverance continuée durant plusieurs années. […]
Le seul tems de la vie qui soit bien propre à faire acquerir leur perfection à l'œil et à la main, est le tems où nos organes, tant intérieurs qu'extérieurs, achevent.
Je dois encore ajouter une réflexion ; c'est que le génie de la Poësie & celui de la Peinture n'habitent point dans un homme d'un temperamment froid & d'une humeur indolente. La même constitution qui le fait Peintre ou Poëte, le dispose aux passions les plus vives. L'histoire des grands Artisans, soit en Poësie soit en Peinture, qui n'ont pas fait naufrage sur les écueils dont je parle, est remplie du moins des dangers qu'ils y ont courus ; quelques-uns s'y sont brisés, mais tous ont échoüé. […]
Conceptual field(s)
Les grands Maîtres font donc des études plus longues que les Artisans ordinaires. Ils sont, si l'on veut, apprentifs durant un plus long-temps, parce qu'ils apprennent encore à un âge où les Artisans ordinaires sçavent déja le peu qu'ils sont capables de sçavoir. Que le titre d'apprentif n'épouvante personne, car il est des apprentifs qui valent déja mieux que des maîtres, bien que ces maîtres fassent moins de fautes qu'eux [...].
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Les hommes de génie qui sont jaloux de leur réputation, ne devroient du moins mettre au jour que de grands ouvrages, puisqu'il ne leur a pas été possible de dérober leur apprentissage aux yeux du public. Ils éviteroient par cette précaution de donner lieu à des comparaisons mortifiantes. Quand les Poëtes & les Peintres les mieux inspirés donnent, ou des Poëmes composés d'un petit nombre de vers, ou des tableaux qui ne contiennent qu'une figure sans expression, & posée dans une attitude commune, ces productions sont exposées à des parallelles odieux. Comme on peut sans génie faire quatre ou cinq vers heureux, ou peindre assez bien une Vierge avec l'Enfant sur ses genoux, sans être grand Peintre, la difference du simple Ouvrier & de l'Artisan divin, ne se fait pas sentir dans des ouvrages plus composés, & qui susceptibles d'un plus grand nombre de beautés. C'est dans ces derniers que cette différence paroit dans toute son étendüe. […]
MARATTA, Carlo
MONNOYER, Jean-Baptiste
RAFFAELLO (Raffaello Sanzio)
VAN DER MEULEN, Adam François
Conceptual field(s)
J'ajouterai encore une consideration touchant les ouvrages qui ne demandent pas beaucoup d'invention, c'est que les faussaires en peinture les contrefont bien plus aisément qu'ils ne peuvent contrefaire les ouvrages où toute l'imagination de l'Artisan a eu lieu de se déploïer. Les faiseurs de Pastiches, ce sont ces tableaux peints dans la maniere d'un grand Artisan, & qu'on expose sous son nom, bien qu'il ne les ait jamais vus ; les faiseurs de Pastiches, dis-je, ne sçauroient contrefaire l'ordonnance, ni le coloris, ni l'expression des grands Maîtres. On imite la main d'un autre, mais on n'imite pas de même, pour parler ainsi, son esprit, & l'on n'apprend point à penser comme un autre, ainsi qu'on peut apprendre à prononcer comme lui.
Le Peintre médiocre qui voudroit contrefaire une grande composition du Dominiquin ou de Rubens, ne sçauroit nous en imposer plus que celui qui voudroit faire un Pastiche sous le nom du Georgeon ou du Titien. Il faudroit avoir un génie presque égal à celui du Peintre qu'on veut contrefaire, pour réussir à faire prendre notre ouvrage pour être de ce Peintre. On ne sçauroit donc contrefaire le génie des grands hommes, mais on réussit quelquefois à contrefaire leur main, c'est-à-dire, leur maniere de coucher la couleur & de tirer les traits, les airs de tête qu'ils répetoient & ce qui pouvoit être de vicieux dans leur pratique. Il est plus facile d'imiter les défauts des hommes que leurs perfections. Par exemple, on reproche au Guide d'avoir fait ses têtes trop plates. Ses têtes manquent souvent de rondeur, parce que leurs parties ne se détachent point & ne s'élevent pas assez l'une sur l'autre. Il suffit donc, pour lui ressembler en cela, de se négliger & de ne point se donner la peine de pratiquer ce que l'art enseigne à faire pour donner de la rondeur à ses têtes [...].
GIORDANO, Luca
GIORGIONE (Giorgio da Castelfranco)
RENI, Guido
RUBENS, Peter Paul
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
J'ajouterai encore une consideration touchant les ouvrages qui ne demandent pas beaucoup d'invention, c'est que les faussaires en peinture les contrefont bien plus aisément qu'ils ne peuvent contrefaire les ouvrages où toute l'imagination de l'Artisan a eu lieu de se déploïer. Les faiseurs de Pastiches, ce sont ces tableaux peints dans la maniere d'un grand Artisan, & qu'on expose sous son nom, bien qu'il ne les ait jamais vus ; les faiseurs de Pastiches, dis-je, ne sçauroient contrefaire l'ordonnance, ni le coloris, ni l'expression des grands Maîtres. On imite la main d'un autre, mais on n'imite pas de même, pour parler ainsi, son esprit, & l'on n'apprend point à penser comme un autre, ainsi qu'on peut apprendre à prononcer comme lui.
Le Peintre médiocre qui voudroit contrefaire une grande composition du Dominiquin ou de Rubens, ne sçauroit nous en imposer plus que celui qui voudroit faire un Pastiche sous le nom du Georgeon ou du Titien. Il faudroit avoir un génie presque égal à celui du Peintre qu'on veut contrefaire, pour réussir à faire prendre notre ouvrage pour être de ce Peintre. On ne sçauroit donc contrefaire le génie des grands hommes, mais on réussit quelquefois à contrefaire leur main, c'est-à-dire, leur maniere de coucher la couleur & de tirer les traits, les airs de tête qu'ils répetoient & ce qui pouvoit être de vicieux dans leur pratique. Il est plus facile d'imiter les défauts des hommes que leurs perfections. Par exemple, on reproche au Guide d'avoir fait ses têtes trop plates. Ses têtes manquent souvent de rondeur, parce que leurs parties ne se détachent point & ne s'élevent pas assez l'une sur l'autre. Il suffit donc, pour lui ressembler en cela, de se négliger & de ne point se donner la peine de pratiquer ce que l'art enseigne à faire pour donner de la rondeur à ses têtes [...].
GIORDANO, Luca
GIORGIONE (Giorgio da Castelfranco)
IL DOMENICHINO (Domenico Zampieri)
RENI, Guido
RUBENS, Peter Paul
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
GIORDANO, Luca
GIORGIONE (Giorgio da Castelfranco)
IL DOMENICHINO (Domenico Zampieri)
RENI, Guido
RUBENS, Peter Paul
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
GIORDANO, Luca
GIORGIONE (Giorgio da Castelfranco)
IL DOMENICHINO (Domenico Zampieri)
RENI, Guido
RUBENS, Peter Paul
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
GIORDANO, Luca
GIORGIONE (Giorgio da Castelfranco)
IL DOMENICHINO (Domenico Zampieri)
RENI, Guido
RUBENS, Peter Paul
TENIERS, David
TIZIANO (Tiziano Vecellio)
Conceptual field(s)
Voilà ma premiere raison pour montrer que les hommes ne naissent pas avec autant de génie dans un païs que dans un autre, & que dans le même païs ils ne naissent pas avec autant de génie dans un temps que dans un autre temps. La seconde ne me paroît pas moins forte que la premiere. C'est qu'il arrive des jours où les hommes portent en peu d'années jusqu'à un point de perfection surprenant les arts & les professions qu'ils cultivoient presque sans aucun fruit depuis plusieurs siècles. Ce prodige survient sans que les causes morales fassent rien de nouveau à quoi l'on puisse attribuer un progrès si miraculeux. Au contraire, les Arts & les Sciences retombent quand les causes morales font des efforts redoublez pour les soûtenir sur le point d'élevation, où il semble qu'une influence secrete les eût portez.
Conceptual field(s)
Enfin, les grands Artisans d'un païs ont presque tous été contemporains. Non-seulement les plus grands Peintres de toutes les Ecoles ont vécu dans le même tems, mais ils ont été les contemporains des grands Poëtes leur compatriotes. Les tems où les arts ont fleuri, se sont encore trouvez féconds en grands sujets dans toutes les sciences, dans toutes les vertus & dans toutes les professions. Il semble qu'il arrive des temps où je ne sçais quel esprit de perfection se répand sur tous les hommes d'un certain païs. Il semble que cet esprit s'en retire après avoir rendu deux ou trois génerations plus parfaites que les génerations précedentes & que les génerations suivantes.
Conceptual field(s)
Or, si la diversité des climats peut mettre tant de varieté & tant de difference dans le teint, dans la stature, dans le corsage des hommes & même dans le son de leur voix, elle doit mettre une difference encore plus grande entre le génie, les inclinations & les mœurs des nations.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Après tout ce que je viens d'exposer, il est plus que vrai-semblable que le génie particulier à chaque peuple, dépend des qualitez de l'air qu'il respire.
Conceptual field(s)
La couleur du vague de l'air, celles des nuages qui font un horison colorié au coucher comme au lever du soleil, dépendent de la nature des exhalaisons qui remplissent l'air & qui se mêlent avec les vapeurs dont ces nuages sont formez. Or tout le monde peut observer que le vague de l'air et les nuages qui brillent à l'horison ne sont pas de la même couleur dans tous les païs. En Italie, par exemple, le vague de l'air est d'un bleu verdâtre, & les nuages de l'horison y sont d'un jaune et d'un rouge très-foncez. Dans les Païs-Bas le vague de l'air est d'un bleu pâle, & les nuages de l'horison n'y sont teints que de couleurs blanchâtres. On peut même remarquer cette différence dans les Ciels des tableaux du Titien & des tableaux de Rubens, ces deux Peintres aïant représenté la nature telle qu'elle se voit en Italie & dans les Païs-Bas où ils la copioient.
Les productions nouvelles sont d'abord apprétiées par des Juges d'un caractere bien different, les gens du métier & le public. Elles seroient bien-tôt estimées à leur juste valeur si le public étoit aussi capable de défendre son sentiment & de le faire valoir, qu'il sçait bien prendre son parti. Mais il a la facilité de se laisser troubler dans son jugement par les personnes qui font profession de l'art auquel l'ouvrage nouveau ressortit. Ces personnes sont sujettes à faire souvent un mauvais rapport par les raisons que nous exposerons. Elles obscurcissent donc la verité, de maniere que le public reste durant un tems dans l'incertitude ou dans l'erreur. Il ne sçait pas précisément quel titre mérite l'ouvrage nouveau défini en géneral. Le public demeure indécis sur la question, s'il est bon ou mauvais à tout prendre, & il en croit même quelquefois les gens du métier qui le trompent, mais il ne les croit que durant un tems assez court. Quand je dis que le jugement du public est désinteressé, je ne prétends pas soutenir qu'il ne se rencontre dans le public des personnes que l'amitié séduit en faveur des Auteurs, & d'autres que l'aversion prévient contr'eux. Mais elles sont en si petit nombre par comparaison aux Juges désinteresses, que leur prévention n'a guères d'influence dans le suffrage général.
Conceptual field(s)
Les productions nouvelles sont d'abord apprétiées par des Juges d'un caractere bien different, les gens du métier & le public. Elles seroient bien-tôt estimées à leur juste valeur si le public étoit aussi capable de défendre son sentiment & de le faire valoir, qu'il sçait bien prendre son parti. Mais il a la facilité de se laisser troubler dans son jugement par les personnes qui font profession de l'art auquel l'ouvrage nouveau ressortit. Ces personnes sont sujettes à faire souvent un mauvais rapport par les raisons que nous exposerons. Elles obscurcissent donc la verité, de maniere que le public reste durant un tems dans l'incertitude ou dans l'erreur. Il ne sçait pas précisément quel titre mérite l'ouvrage nouveau défini en géneral. Le public demeure indécis sur la question, s'il est bon ou mauvais à tout prendre, & il en croit même quelquefois les gens du métier qui le trompent, mais il ne les croit que durant un tems assez court. Quand je dis que le jugement du public est désinteressé, je ne prétends pas soutenir qu'il ne se rencontre dans le public des personnes que l'amitié séduit en faveur des Auteurs, & d'autres que l'aversion prévient contr'eux. Mais elles sont en si petit nombre par comparaison aux Juges désinteresses, que leur prévention n'a guères d'influence dans le suffrage général.
Non seulement le public juge d'un ouvrage sans interêt, mais il en juge encore ainsi qu'il en faut décider en general, c'est-à-dire par la voïe du sentiment, & suivant l'impression que le poëme ou le tableau font sur lui. Puisque le premier but de la Poësie & de la Peinture est de nous toucher, les poëmes & les tableaux ne sont de bons ouvrages qu'à proportion qu'ils nous émeuvent & qu'ils nous attachent. Un ouvrage qui touche beaucoup doit être excellent à tout prendre. Par la même raison l'ouvrage qui ne touche point & qui n'attache pas ne vaut rien, & si la critique n'y trouve point à reprendre des fautes contre les regles, c'est qu'un ouvrage peut être mauvais sans qu'il y ait des fautes contre les regles, comme un ouvrage plein de fautes contre les regles peut être un ouvrage excellent.
Or le sentiment enseigne bien mieux si l'ouvrage touche, & s'il fait sur nous l'impression que doit faire un ouvrage, que toutes les dissertations composées par les Critiques, pour en expliquer le mérite, & pour en calculer les perfections & les défauts. La voie de discussion & d'analyse, dont se servent ces Messieurs, est bonne à la verité, lorsqu'il s'agit de trouver les causes qui font qu'un ouvrage plaît ou qu'il ne plaît pas ; mais cette voie ne vaut pas celle du sentiment lorsqu'il s'agit de décider cette question. L'ouvrage plaît-il ou ne plaît-il pas ? L'ouvrage est-il bon ou mauvais en géneral ? C'est la même chose. Le raisonnement ne doit donc intervenir dans le jugement que nous portons sur un poëme ou sur un tableau, que pour rendre raison de la décision du sentiment & pour expliquer quelles fautes l'empêchent de plaire, & quels sont les agrémens qui le rendent capable d'attacher. Qu'on me permette ce trait.
La raison ne veut point qu'on raisonne sur une pareille question, à moins qu'on ne raisonne pour justifier le jugement que le sentiment a porté. La décision de la question n'est point du ressort du raisonnement. Il doit se soumettre au jugement que le sentiment prononce. C'est le juge compétent de la question.
Non seulement le public juge d'un ouvrage sans interêt, mais il en juge encore ainsi qu'il en faut décider en general, c'est-à-dire par la voïe du sentiment, & suivant l'impression que le poëme ou le tableau font sur lui. Puisque le premier but de la Poësie & de la Peinture est de nous toucher, les poëmes & les tableaux ne sont de bons ouvrages qu'à proportion qu'ils nous émeuvent & qu'ils nous attachent. Un ouvrage qui touche beaucoup doit être excellent à tout prendre. Par la même raison l'ouvrage qui ne touche point & qui n'attache pas ne vaut rien, & si la critique n'y trouve point à reprendre des fautes contre les regles, c'est qu'un ouvrage peut être mauvais sans qu'il y ait des fautes contre les regles, comme un ouvrage plein de fautes contre les regles peut être un ouvrage excellent.
Or le sentiment enseigne bien mieux si l'ouvrage touche, & s'il fait sur nous l'impression que doit faire un ouvrage, que toutes les dissertations composées par les Critiques, pour en expliquer le mérite, & pour en calculer les perfections & les défauts. La voie de discussion & d'analyse, dont se servent ces Messieurs, est bonne à la verité, lorsqu'il s'agit de trouver les causes qui font qu'un ouvrage plaît ou qu'il ne plaît pas ; mais cette voie ne vaut pas celle du sentiment lorsqu'il s'agit de décider cette question. L'ouvrage plaît-il ou ne plaît-il pas ? L'ouvrage est-il bon ou mauvais en géneral ? C'est la même chose. Le raisonnement ne doit donc intervenir dans le jugement que nous portons sur un poëme ou sur un tableau, que pour rendre raison de la décision du sentiment & pour expliquer quelles fautes l'empêchent de plaire, & quels sont les agrémens qui le rendent capable d'attacher. Qu'on me permette ce trait.
La raison ne veut point qu'on raisonne sur une pareille question, à moins qu'on ne raisonne pour justifier le jugement que le sentiment a porté. La décision de la question n'est point du ressort du raisonnement. Il doit se soumettre au jugement que le sentiment prononce. C'est le juge compétent de la question.
Raisonne-t-on pour savoir si le ragoût est bon ou s'il est mauvais […] On n'en fait rien. Il est en nous un sens fait pour connoître si le Cuisinier a operé suivant les regles de son art. On goûte le ragoût, & même sans savoir ces regles, on connoît s'il est bon. Il en est de même en quelque maniere des ouvrages d'esprit & des tableaux faits pour nous plaire en nous touchant.
Il est en nous un sens destiné pour juger du mérite de ces ouvrages, qui consiste en l'imitation des objets touchans dans la nature. Ce sens est le sens même qui auroit jugé de l'objet que le Peintre, le Poëte ou le Musicien ont imité. C'est l'œil, lorsqu'il s'agit du coloris du tableau […] Lorsqu'il s'agit de connoître si l'imitation qu'on nous présente dans un poëme ou dans la composition d'un tableau, est capable d'exciter la compassion & d'attendrir, le sens destiné pour en juger, est le sens même qui auroit été attendri, c'est le sens qui auroit jugé de l'objet imité. C'est ce sixième sens qui est en nous, sans que nous voïions ses organes. C'est la portion de nous-mêmes qui juge sur l'impression qu'elle ressent, & qui pour me servir des termes de Platon, prononce, sans consulter la regle & le compas. C'est enfin ce qu'on appelle communément le sentiment.
Le cœur s'agite de lui-même, & par un mouvement qui précede toute délibération, quand l'objet qu'on lui présente est réellement un objet touchant, soit que l'objet ait reçu son être de la nature, soit qu'il tienne son existence d'une imitation que l'art en a faite. Notre cœur est fait, il est organisé pour cela. Son opération prévient donc tous les raisonnemens, ainsi que l'operation de l'œil & celle de l'oreille les devancent dans leurs sensations.
Faut-il, pour juger si ce portrait ressemble ou non, prendre les proportions du visage de notre ami, & les comparer aux proportions du portrait ? Les Peintres mêmes diront qu'il est en eux un sentiment subit qui devance tout examen, & que l'excellent tableau qu'ils n'ont jamais vu, fait sur eux une impression soudaine qui les met en état de pouvoir, avant aucune discussion, de juger de son mérite en général : cette premiere appréhension leur suffit même pour nommer le noble Artisan du tableau.
On a donc raison de dire communément qu'avec de l'esprit on se connoît à tout, car on entend alors par le mot d'esprit, la justesse & la délicatesse du sentiment. […]
Conceptual field(s)
Si le mérite le plus important des poëmes & des tableaux étoit d'être conforme aux regles rédigées par écrit, on pourroit dire que la meilleure maniere de juger de leur excellence, comme du rang qu'ils doivent tenir dans l'estime des hommes, seroit la voïe de discussion et d'analyse. Mais le mérite le plus important des poëmes & des tableaux est de nous plaire. C'est le dernier but que les Peintres & les Poëtes se proposent, quand ils prennent tant de peine à se conformer aux regles de leur art. On connoît donc suffisamment s'ils ont bien réussi, quand on connoît si l'ouvrage touche ou s'il ne touche pas. Il est vrai de dire qu'un ouvrage où les regles essentielles seroient violées, ne sçauroit plaire. Mais c'est ce qu'on reconnoît mieux en jugeant par l'impression que fait l'ouvrage qu'en jugeant de cet ouvrage sur les dissertations des Critiques, qui conviennent rarement touchant l'importance de chaque regle. Ainsi le public est capable de bien juger des vers & des tableaux sans sçavoir les regles de la Poësie & de la Peinture, car, comme le dit Ciceron (a) Omnes tacito quodam sensu sine ulla arte aut ratione, quæ sint in artibus ac rationibus prava aut recta dijudicant. Tous les hommes, à l'aide du sentiment intérieur qui est en eux, connoissent sans sçavoir les regles, si les productions des arts sont de bons ou de mauvais ouvrages, & si le raisonnement qu'ils entendent conclut bien.
(a) De Orat. lib. 3.
Si le mérite le plus important des poëmes & des tableaux étoit d'être conforme aux regles rédigées par écrit, on pourroit dire que la meilleure maniere de juger de leur excellence, comme du rang qu'ils doivent tenir dans l'estime des hommes, seroit la voïe de discussion et d'analyse. Mais le mérite le plus important des poëmes & des tableaux est de nous plaire. C'est le dernier but que les Peintres & les Poëtes se proposent, quand ils prennent tant de peine à se conformer aux regles de leur art. On connoît donc suffisamment s'ils ont bien réussi, quand on connoît si l'ouvrage touche ou s'il ne touche pas. Il est vrai de dire qu'un ouvrage où les regles essentielles seroient violées, ne sçauroit plaire. Mais c'est ce qu'on reconnoît mieux en jugeant par l'impression que fait l'ouvrage qu'en jugeant de cet ouvrage sur les dissertations des Critiques, qui conviennent rarement touchant l'importance de chaque regle. Ainsi le public est capable de bien juger des vers & des tableaux sans sçavoir les regles de la Poësie & de la Peinture, car, comme le dit Ciceron (a) Omnes tacito quodam sensu sine ulla arte aut ratione, quæ sint in artibus ac rationibus prava aut recta dijudicant. Tous les hommes, à l'aide du sentiment intérieur qui est en eux, connoissent sans sçavoir les regles, si les productions des arts sont de bons ou de mauvais ouvrages, & si le raisonnement qu'ils entendent conclut bien.
(a) De Orat. lib. 3.
Conceptual field(s)
Mais il est des beautez dans ces sortes d'ouvrages, dira-t-on, dont les ignorans ne peuvent sentir le prix. Par exemple, un homme qui ne sçait pas que le même Pharnace qui s'étoit allié aux Romains contre son pere Mithridate, fut dépoüillé honteusement de ses Etats par Jules Cesar quelques années après, n'est point frappé de la beauté des vers prophétiques que Racine fait proferer à Mithridate expirant.
Tôt ou tard il faudra que Pharnace périsse, fiez-vous aux romains du soin de son supplice.
Les ignorans ne sçauroient donc juger d'un poëme en géneral, puisqu'ils ne conçoivent qu'une partie de ses beautez.
Je prie le lecteur de ne point oublier la premiere réponse que je vais faire à cette objection. C'est que je ne comprens point le bas peuple dans le public capable de prononcer sur les poëmes ou sur les tableaux, comme de décider à quel dégré ils sont excellens. Le mot de public ne renferme ici que les personnes qui ont acquis des lumieres, soit par la lecture, soit par le commerce du monde. Elles sont les seules qui puissent marquer le rang des poëmes & des tableaux, quoiqu'il se rencontre dans les ouvrages excellens des beautez capables de se faire sentir au peuple du plus bas étage & de l'obliger à se récrier. Mais comme il est sans connoissance des autres ouvrages, il n'est pas en état de discerner à quel point le poëme qui le fait pleurer est excellent, ni quel rang il doit tenir parmi les autres poëmes. Le public dont il s'agit ici est donc borné aux personnes qui lisent, qui connoissent les spectacles, qui voient et qui entendent parler de tableaux, ou qui ont acquis de quelque maniere que ce soit, ce discernement qu'on appelle goût de comparaison.
Conceptual field(s)
Mais il est des beautez dans ces sortes d'ouvrages, dira-t-on, dont les ignorans ne peuvent sentir le prix. Par exemple, un homme qui ne sçait pas que le même Pharnace qui s'étoit allié aux Romains contre son pere Mithridate, fut dépoüillé honteusement de ses Etats par Jules Cesar quelques années après, n'est point frappé de la beauté des vers prophétiques que Racine fait proferer à Mithridate expirant.
Tôt ou tard il faudra que Pharnace périsse, fiez-vous aux romains du soin de son supplice.
Les ignorans ne sçauroient donc juger d'un poëme en géneral, puisqu'ils ne conçoivent qu'une partie de ses beautez.
Je prie le lecteur de ne point oublier la premiere réponse que je vais faire à cette objection. C'est que je ne comprens point le bas peuple dans le public capable de prononcer sur les poëmes ou sur les tableaux, comme de décider à quel dégré ils sont excellens. Le mot de public ne renferme ici que les personnes qui ont acquis des lumieres, soit par la lecture, soit par le commerce du monde. Elles sont les seules qui puissent marquer le rang des poëmes & des tableaux, quoiqu'il se rencontre dans les ouvrages excellens des beautez capables de se faire sentir au peuple du plus bas étage & de l'obliger à se récrier. Mais comme il est sans connoissance des autres ouvrages, il n'est pas en état de discerner à quel point le poëme qui le fait pleurer est excellent, ni quel rang il doit tenir parmi les autres poëmes. Le public dont il s'agit ici est donc borné aux personnes qui lisent, qui connoissent les spectacles, qui voient et qui entendent parler de tableaux, ou qui ont acquis de quelque maniere que ce soit, ce discernement qu'on appelle goût de comparaison.
Le mot de public est encore ou plus resserré ou plus étendu, suivant les temps et suivant les lieux dont on parle. Il est des siècles & des villes où les connoissances necessaires, pour bien juger d'un ouvrage par son effet, sont plus communes & plus répanduës que dans d'autres. Tel ordre de citoïens qui n'a pas ces lumieres dans une ville de Province, les a dans une Capitale. Tel ordre de citoïens qui ne les avoit pas au commencement du seiziéme siècle, les avoit à la fin du dix-septiéme.
Conceptual field(s)
Le dessein de la Poësie & de la Peinture étant de toucher & de plaire, il faut que tout homme qui n'est pas stupide, puisse sentir l'effet des bons vers & des bons tableaux. Tous les hommes doivent donc être en possession de donner leur propre suffrage, quand il s'agit de décider si les poëmes ou les tableaux sont l'effet qu'ils doivent faire. Ainsi, lorsqu'il s'agit de juger de l'effet général d'un ouvrage, le Peintre & le Poëte sont aussi peu en droit de recuser ceux qui ne sçavent pas leur art, qu'un Chirurgien serait en droit de récuser le témoignage de celui qui a souffert une opération. […]
Il est vrai, que lorsqu'il s'agit du mérite des tableaux, le public n'est pas un juge aussi compétent, que lorsqu'il s'agit des mérites des poëmes. La perfection d'une partie des beautés d'un tableau, par exemple, la perfection du dessein n'est bien sensible qu'aux Peintres ou aux Connoisseurs qui ont étudié la Peinture autant que les Artisans mêmes. Mais nous discutons ailleurs [section 27] quelles sont les beautés d'un tableau dont le public est un juge non recusable, & quelles sont les beautés qui ne sçauroient être appréciées à leur juste valeur, que par ceux qui sçavent les regles de la Peinture.
Véritablement les personnes qui ne sçavent point l'art, ne sont pas capables de remonter jusques aux causes qui rendent un mauvais poëme ennuïeux. Elles ne sçauroient en indiquer les fautes en particulier. Aussi ne prétens-je pas que l'ignorant puisse dire précisement en quoi le Peintre ou le Poëte ont manqué, & moins encore leur donner des avis sur la correction de chaque faute, mais cela n'empêche pas que l'ignorant ne puisse juger par l'impression que fait sur lui un ouvrage composé pour lui plaire et pour l'intéresser, si l'Auteur a réussi dans son entreprise & jusqu'à quel point il y a réussi. L'ignorant peut donc dire que l'ouvrage est bon ou qu'il ne vaut rien, et même il est faux qu'il ne rende pas raison de son jugement. Le Poëte tragique, dira-t-il, ne l'a point fait pleurer, & le Poëte comique ne l'a point fait rire. Il allegue qu'il ne sent aucun plaisir en regardant le tableau qu'il refuse d'estimer. C'est aux ouvrages à se défendre eux-mêmes contre de pareilles critiques [...]
Conceptual field(s)
[…] il convient de parler des jugemens que les gens de métier en portent. La plûpart juge mal des ouvrages pris en général, par trois raisons. La sensibilité des gens du métier est usée. Ils jugent du tout par voie de discussion. Enfin ils sont prévenus en faveur de quelque partie de l'art, & ils la comptent dans les jugements généraux qu'ils portent pour plus qu'elle ne vaut. Sous le nom de gens de métier, je comprens ici, non -seulement les personnes qui composent ou qui peignent, mais encore un grand nombre de ceux qui écrivent sur les poëmes & sur les tableaux.Quoi, me dira-t-on, plus on est ignorant en Poësie & en Peinture, plus on est en état de juger sainement des poëmes & des tableaux ! Quel Paradoxe !
Il est quelques Artisans beaucoup plus capables que le commun des hommes, de porter un bon jugement sur les ouvrages de leur art. Ce sont les Artisans nez avec le génie de cet art, toujours accompagné d'un sentiment bien plus exquis, que n'est celui du commun des hommes. Mais un petit nombre d'Artisans est né avec du génie, & par conséquent avec cette sensibilité ou cette délicatesse d'organe superieure à celle que peuvent avoir les autres, & je soutiens que les Artisans sans génie jugent moins sainement que le commun des hommes , & si l'on veut, que les ignorans. Voici mes raisons. La sensibilité vient à s'user dans un Artisan sans genie, & ce qu'il apprend dans la pratique de son art, se sert le plus souvent qu'à dépraver son goût naturel. […]
D’ailleurs les Peintres & les Poètes s’occupent à des imitations comme d’un travail au lieu que les autres hommes ne les regardent que comme des objets intéressans. Ainsi le sujet de l'imitation, c'est-à-dire, les événements de la tragédie et les expressions du tableau, font une impression légère sur les peintres et sur les poètes sans génie, qui sont ceux dont je parle. Ils sont en habitude d'être émus si faiblement, qu'ils ne s'aperçoivent presque pas si l'ouvrage les touche ou s'il ne les touche point. Leur attention se porte toute entière sur l'exécution mécanique, et c'est par là qu'ils jugent de tout l'ouvrage. La poësie du tableau de Monsieur Coypel, qui représente le sacrifice de la fille de Jephté, ne les saisit point, & ils l'examinent avec autant d'indifférence que s'il représentoit une danse de païsans, ou quelque sujet incapable de nous émouvoir. […].
Conceptual field(s)
Les Peintres & les Poëtes, sans enthousiasme, ne sentent pas celui des autres, & portant leur suffrage par voïe de discussion, ils loüent ou ils blâment un ouvrage en géneral ; ils le définissent bon ou mauvais suivant qu'ils le trouvent régulier dans l'analyse qu'ils en font. Peuvent-ils être bons juges du tout, quand ils sont mauvais juges de la partie de l'invention, qui fait le principal mérite des ouvrages, & qui distingue le grand Homme du simple artisan.
Le plus grand effet des préjugez que les Peintres & les Poëtes sement dans le monde contre un nouvel ouvrage, vient de ce que les personnes qui parlent d'un poëme ou d'un tableau sur la foi d'autrui, aiment mieux en passer par l'avis des gens du métier, elles aiment mieux le repeter, que de redire le sentiment de gens qui n'ont pas mis l'enseigne de la profession à laquelle l'ouvrage ressortit. En ces sortes de choses où les hommes ne croïent point avoir un intérêt essentiel à choisir le bon parti, ils se laissent ébloüir par une raison qui peut beaucoup sur eux. C'est que les gens du métier doivent avoir plus d'expérience que les autres. Je dis ébloüir, car comme je l'ai exposé, la plûpart des Peintres & des Poëtes ne jugent point par voïe de sentiment, ni en déferant au goût naturel perfectionné par les comparaisons & par l'expérience, mais par voïe d'analyse.
Un Peintre, qui de tous les talens nécessaires pour former le grand Artisan, n'a que celui de bien colorier, décide qu'un tableau est excellent, ou qu'il ne vaut rien en général, suivant que l'ouvrier a sçu manier la couleur. La poësie du tableau est comptée pour peu de chose, pour rien même dans son jugement. Il fait sa décision sans aucun égard aux parties de l'art qu'il n'a point […].
Il faut bien que les gens du métier se trompent souvent, puisque leurs jugemens sont ordinairement cassez par ceux du public, dont la voix fit toujours la destinée des ouvrages. C'est toujours le sentiment du public qui l'emporte, lorsque les Maîtres de l'art & lui sont d'avis differens sur une production nouvelle.
Conceptual field(s)
Nous avons vu que les beautez de l'exécution pouvoient seules rendre un tableau précieux. Or ces beautez se rendent bien sensibles aux hommes qui n'ont pas l'intelligence de la mécanique de la Peinture, mais ils ne sont pas capables pour cela de juger du mérite du Peintre. Pour être capable de juger de la loüange qui lui est dûë, il faut sçavoir à quel degré il a approché des Artisans qui sont les plus vantez pour avoir excellé dans les parties où il a réussi lui-même. […] Ainsi la réputation du Peintre, dont le talent est de réussir dans le clair-obscur ou dans la couleur locale, est bien plus dépendante du suffrage de ses pairs, que la réputation de celui dont le mérite consiste dans l'expression des passions & dans les inventions poëtiques, choses où le public se connoît mieux, qu'il compare par lui-même, & dont il juge par lui-même.[….].
On voit bien, qu'en suivant ce principe, je dois reconnoître les personnes du métier pour être les juges auxquels il faut s'en rapporter, quand on veut sçavoir, autant qu'il est possible, quel Peintre a fait le tableau ; mais elles ne sont point pour cela les juges uniques du mérite de ce tableau. Comme les plus grands ouvriers en ont fait quelquefois de médiocres, on ne connoît pas l'excellence d'un tableau, dès qu'on connaît son Auteur.
Quoique l'expérience nous enseigne que l'art de deviner l'auteur d'un tableau en reconnoissant la main du maître, soit le plus fautif de tous les arts après la médecine, il prévient trop néanmoins le public en faveur des décisions de ceux qui l'exercent, même quand elles sont faites sur d'autres points. Les hommes qui admirent plus volontiers qu'ils n'approuvent, écoutent avec soumission, & ils répetent avec confiance tous les jugemens d'une personne qui montre une connoissance distincte de plusieurs choses où ils n'entendent rien. On verra d'ailleurs par ce que je vais dire concernant l'infaillibilité de l'art de discerner la main des grands maîtres, quelles bornes on doit donner à la prévention qui nous est naturelle en faveur de tous les jugemens rendus par ceux qui font profession de cet art, & qui décident avec autant de confiance qu'un jeune Médecin ordonne des remedes.
Quoique l'expérience nous enseigne que l'art de deviner l'auteur d'un tableau en reconnoissant la main du maître, soit le plus fautif de tous les arts après la médecine, il prévient trop néanmoins le public en faveur des décisions de ceux qui l'exercent, même quand elles sont faites sur d'autres points. Les hommes qui admirent plus volontiers qu'ils n'approuvent, écoutent avec soumission, & ils répetent avec confiance tous les jugemens d'une personne qui montre une connoissance distincte de plusieurs choses où ils n'entendent rien. On verra d'ailleurs par ce que je vais dire concernant l'infaillibilité de l'art de discerner la main des grands maîtres, quelles bornes on doit donner à la prévention qui nous est naturelle en faveur de tous les jugemens rendus par ceux qui font profession de cet art, & qui décident avec autant de confiance qu'un jeune Médecin ordonne des remedes.
On sçait que plusieurs Peintres se sont trompez sur leurs propres ouvrages, & qu'ils ont pris quelquefois une copie pour l'original qu'eux-mêmes ils avoient peint. Vasari raconte, comme témoin oculaire, que Jules Romain, après avoir fait lui-même la draperie dans un tableau que peignoit Raphaël, reconnut pour son original la copie qu'André Del Sarte avoit faite de ce tableau.
407
Conceptual field(s)
407
Conceptual field(s)
Enfin le tems arrive où le public apprétie un ouvrage, non plus sur le rapport des gens du métier, mais suivant l'impression que fait cet ouvrage. Les personnes qui en avoient jugé autrement que les gens de l'art, & en s'en rapportant au sentiment, s'entrecommuniquent leurs avis, & l'uniformité de leur opinion change en persuasion l'opinion de chaque particulier. Il se forme encore de nouveaux maîtres dans les arts, qui jugent sans intérêt & avec équité des ouvrages calomniez. Ces maîtres désabusent le monde méthodiquement des préventions que leurs prédecesseurs y avoient semées. Le monde remarque encore de lui-même, que ceux qui lui avoient promis quelque chose de meilleur que l'ouvrage dont le mérite a été contesté, ne lui ont pas tenu parole. Les contradicteurs obstinez meurent d'un autre côté. Ainsi l'ouvrage se trouve géneralement estimé à sa valeur véritable.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Enfin le tems arrive où le public apprétie un ouvrage, non plus sur le rapport des gens du métier, mais suivant l'impression que fait cet ouvrage. Les personnes qui en avoient jugé autrement que les gens de l'art, & en s'en rapportant au sentiment, s'entrecommuniquent leurs avis, & l'uniformité de leur opinion change en persuasion l'opinion de chaque particulier. Il se forme encore de nouveaux maîtres dans les arts, qui jugent sans intérêt & avec équité des ouvrages calomniez. Ces maîtres désabusent le monde méthodiquement des préventions que leurs prédecesseurs y avoient semées. Le monde remarque encore de lui-même, que ceux qui lui avoient promis quelque chose de meilleur que l'ouvrage dont le mérite a été contesté, ne lui ont pas tenu parole. Les contradicteurs obstinez meurent d'un autre côté. Ainsi l'ouvrage se trouve géneralement estimé à sa valeur véritable.
En second lieu, comme le public n'est pas également éclairé dans tous les païs, il est des lieux où les gens du métier peuvent le tenir plus long-temps dans l'erreur qu'ils ne le peuvent tenir en d'autres contrées. Par exemple, les tableaux exposez dans Rome seront plutôt apprétiez à leur juste valeur, que s'ils étoient exposez dans Londres ou dans Paris. Les Romains naissent presque tous avec beaucoup de sensibilité pour la peinture, & leur goût naturel a encore des occasions fréquentes de se nourrir & de se perfectionner par les ouvrages excellens qu'on rencontre dans les églises, dans les palais, & presque dans toutes les maisons où l'on peut entrer. Les mœurs & les usages du païs y laissent encore un grand vuide dans les journées de tout le monde, même dans celles de ces Artisans condamnez ailleurs à un travail qui n'a gueres plus de relâche que le travail des Danaïdes. Cette inaction, l'occasion continuelle de voir de beaux tableaux, & peut-être aussi la sensibilité des organes plus grande dans ces contrées-là que dans des païs froids & humides, rendent le goût pour la peinture si géneral à Rome, qu'il est ordinaire d'y voir des tableaux de prix jusques dans des boutiques de Barbiers, & ces Messieurs en expliquent avec emphase les beautez à tous venans, pour satisfaire à la nécessité d'entretenir le monde, que leur profession leur imposoit dès le temps d'Horace. Enfin dans une nation industrieuse & capable de prendre toute sorte de peine pour gagner sa vie, sans être assujettie à un travail reglé, il s'est formé un peuple entier de gens qui cherchent à faire quelque profit par le moïen du commerce des tableaux. Ainsi le public de Rome est presque composé en entier de connoisseurs en peinture. Ils sont, si l'on veut, la plûpart des Connoisseurs médiocres, mais du moins ils ont un goût de comparaison qui empêche les gens du métier de leur en imposer aussi facilement qu'ils peuvent en imposer ailleurs. Si le public de Rome n'en sçait point assez pour réfuter méthodiquement leurs faux raisonnemens, il en sçait assez du moins pour en sentir l'erreur, & il s'informe après l'avoir sentie de ce qu'il faut dire pour la refuter. D'un autre côté les gens du métier deviennent plus circonspects lorsqu'ils sentent qu'ils ont affaire avec des hommes éclairez. Ce n'est point parmi les Théologiens que les Novateurs entreprennent de faire des Prosélites de bonne foi.
Conceptual field(s)
En second lieu, comme le public n'est pas également éclairé dans tous les païs, il est des lieux où les gens du métier peuvent le tenir plus long-temps dans l'erreur qu'ils ne le peuvent tenir en d'autres contrées. Par exemple, les tableaux exposez dans Rome seront plutôt apprétiez à leur juste valeur, que s'ils étoient exposez dans Londres ou dans Paris. Les Romains naissent presque tous avec beaucoup de sensibilité pour la peinture, & leur goût naturel a encore des occasions fréquentes de se nourrir & de se perfectionner par les ouvrages excellens qu'on rencontre dans les églises, dans les palais, & presque dans toutes les maisons où l'on peut entrer. Les mœurs & les usages du païs y laissent encore un grand vuide dans les journées de tout le monde, même dans celles de ces Artisans condamnez ailleurs à un travail qui n'a gueres plus de relâche que le travail des Danaïdes. Cette inaction, l'occasion continuelle de voir de beaux tableaux, & peut-être aussi la sensibilité des organes plus grande dans ces contrées-là que dans des païs froids & humides, rendent le goût pour la peinture si géneral à Rome, qu'il est ordinaire d'y voir des tableaux de prix jusques dans des boutiques de Barbiers, & ces Messieurs en expliquent avec emphase les beautez à tous venans, pour satisfaire à la nécessité d'entretenir le monde, que leur profession leur imposoit dès le temps d'Horace. Enfin dans une nation industrieuse & capable de prendre toute sorte de peine pour gagner sa vie, sans être assujettie à un travail reglé, il s'est formé un peuple entier de gens qui cherchent à faire quelque profit par le moïen du commerce des tableaux. Ainsi le public de Rome est presque composé en entier de connoisseurs en peinture. Ils sont, si l'on veut, la plûpart des Connoisseurs médiocres, mais du moins ils ont un goût de comparaison qui empêche les gens du métier de leur en imposer aussi facilement qu'ils peuvent en imposer ailleurs. Si le public de Rome n'en sçait point assez pour réfuter méthodiquement leurs faux raisonnemens, il en sçait assez du moins pour en sentir l'erreur, & il s'informe après l'avoir sentie de ce qu'il faut dire pour la refuter. D'un autre côté les gens du métier deviennent plus circonspects lorsqu'ils sentent qu'ils ont affaire avec des hommes éclairez. Ce n'est point parmi les Théologiens que les Novateurs entreprennent de faire des Prosélites de bonne foi.
Le public ne se connoît pas en peinture à Paris autant qu'à Rome. Les François en géneral n'ont pas le sentiment intérieur aussi vif que les Italiens. La difference qui est entr'eux est déja sensible dans les peuples qui habitent aux pieds des Alpes du côté des Gaules & du côté de l'Italie ; mais elle est encore bien plus grande entre les naturels de Paris & les naturels de Rome. Il s'en faut encore beaucoup que nous ne cultivions autant qu'eux la sensibilité pour la peinture, commune à tous les hommes. Géneralement parlant, on n'acquiert pas ici aussi-bien qu'à Rome le goût de comparaison. Ce goût se forme en nous-mêmes & sans que nous y pensions. A force de voir des tableaux durant la jeunesse, l'idée, l'image d'une douzaine d'excellens tableaux se grave & s'imprime profondément dans notre cerveau encore tendre. Or, ces tableaux qui nous sont toujours présens, et dont le rang est certain, dont le mérite est décidé, servent, s'il est permis de parler ainsi, de pieces de comparaison, qui donnent le moïen de juger sainement à quel point l'ouvrage nouveau qu'on expose sous nos yeux approche de la perfection où les autres peintres ont atteint, & dans quelle classe il est digne d'être placé. L'idée de ces douze tableaux qui nous est présente, produit une partie de l'effet que les tableaux mêmes produiroient, s'ils étoient à côté de celui dont nous voulons discerner le mérite & connoître le rang. La difference qui peut se trouver entre le mérite de deux tableaux exposez à côté l'un de l'autre, frappe tous ceux qui ne sont pas stupides.
Mais pour acquerir ce goût de comparaison qui fait juger du tableau présent par le tableau absent, il faut avoir été nourris dans le sein de la Peinture. Il faut, principalement durant la jeunesse, avoir eu des occasions fréquentes de voir dans une assiete d'esprit tranquille des tableaux. La liberté d'esprit n'est guéres moins necessaire pour sentir toute la beauté d'un ouvrage que pour le composer. Pour être bon spectateur il faut avoir cette tranquillité d'ame qui ne naît pas de l'épuisement, mais bien de la sérenité de l'imagination.
Le public ne se connoît pas en peinture à Paris autant qu'à Rome. Les François en géneral n'ont pas le sentiment intérieur aussi vif que les Italiens. La difference qui est entr'eux est déja sensible dans les peuples qui habitent aux pieds des Alpes du côté des Gaules & du côté de l'Italie ; mais elle est encore bien plus grande entre les naturels de Paris & les naturels de Rome. Il s'en faut encore beaucoup que nous ne cultivions autant qu'eux la sensibilité pour la peinture, commune à tous les hommes. Géneralement parlant, on n'acquiert pas ici aussi-bien qu'à Rome le goût de comparaison. Ce goût se forme en nous-mêmes & sans que nous y pensions. A force de voir des tableaux durant la jeunesse, l'idée, l'image d'une douzaine d'excellens tableaux se grave & s'imprime profondément dans notre cerveau encore tendre. Or, ces tableaux qui nous sont toujours présens, et dont le rang est certain, dont le mérite est décidé, servent, s'il est permis de parler ainsi, de pieces de comparaison, qui donnent le moïen de juger sainement à quel point l'ouvrage nouveau qu'on expose sous nos yeux approche de la perfection où les autres peintres ont atteint, & dans quelle classe il est digne d'être placé. L'idée de ces douze tableaux qui nous est présente, produit une partie de l'effet que les tableaux mêmes produiroient, s'ils étoient à côté de celui dont nous voulons discerner le mérite & connoître le rang. La difference qui peut se trouver entre le mérite de deux tableaux exposez à côté l'un de l'autre, frappe tous ceux qui ne sont pas stupides.
Mais pour acquerir ce goût de comparaison qui fait juger du tableau présent par le tableau absent, il faut avoir été nourris dans le sein de la Peinture. Il faut, principalement durant la jeunesse, avoir eu des occasions fréquentes de voir dans une assiete d'esprit tranquille des tableaux. La liberté d'esprit n'est guéres moins necessaire pour sentir toute la beauté d'un ouvrage que pour le composer. Pour être bon spectateur il faut avoir cette tranquillité d'ame qui ne naît pas de l'épuisement, mais bien de la sérenité de l'imagination.
Conceptual field(s)
Dès qu'on ne retrouve plus dans une traduction les mots choisis par l'Auteur, ni l'arrangement où il les avoit placez pour plaire à l'oreille & pour émouvoir le cœur, on peut dire que juger d'un poëme en géneral sur sa version, c'est vouloir juger du tableau d'un grand maître, vanté principalement pour son coloris, sur une estampe où le trait de son dessein seroit encore corrompu. Un poëme perd dans la traduction l'harmonie & le nombre que je compare au coloris d'un tableau. Il y perd la poësie du stile que je compare au dessein & à l'expression. Une traduction est une estampe où rien ne demeure du tableau original que l'ordonnance & l'attitude des figures. Encore y est-elle alterée.
Conceptual field(s)
Conceptual field(s)
Ainsi l'homme qui est né avec le génie le plus heureux est celui qui va plus loin que les autres dans ces sortes de professions, & cela indépendamment du dégré de perfection où elles se trouvent lorsqu'il les exerce. Il lui suffit que la profession qu'il embrasse soit déja réduite en art, & que la pratique de cet art ait une méthode. Il pourroit lui-même inventer l'art & rédiger la méthode. La force de son génie, qui lui fait deviner & imaginer un nombre infini de choses, qui ne sont pas à portée des esprits ordinaires, lui donne plus d'avantage sur les esprits ordinaires, qui professeront un jour le même art que lui, après que cet art aura été perfectionné, que ces esprits n'en pourront avoir sur lui, par la connoissance qu'ils auront des nouvelles découvertes & par les nouvelles lumieres dont l'art se trouvera enrichi, lorsqu'ils viendront à le professer à leur tour. Le secours que donne la perfection où l'un des arts dont nous parlons est arrivé, ne sçauroit mener les esprits ordinaires aussi loin que la supériorité de lumieres & de vûës naturelles, peut porter un homme de génie.